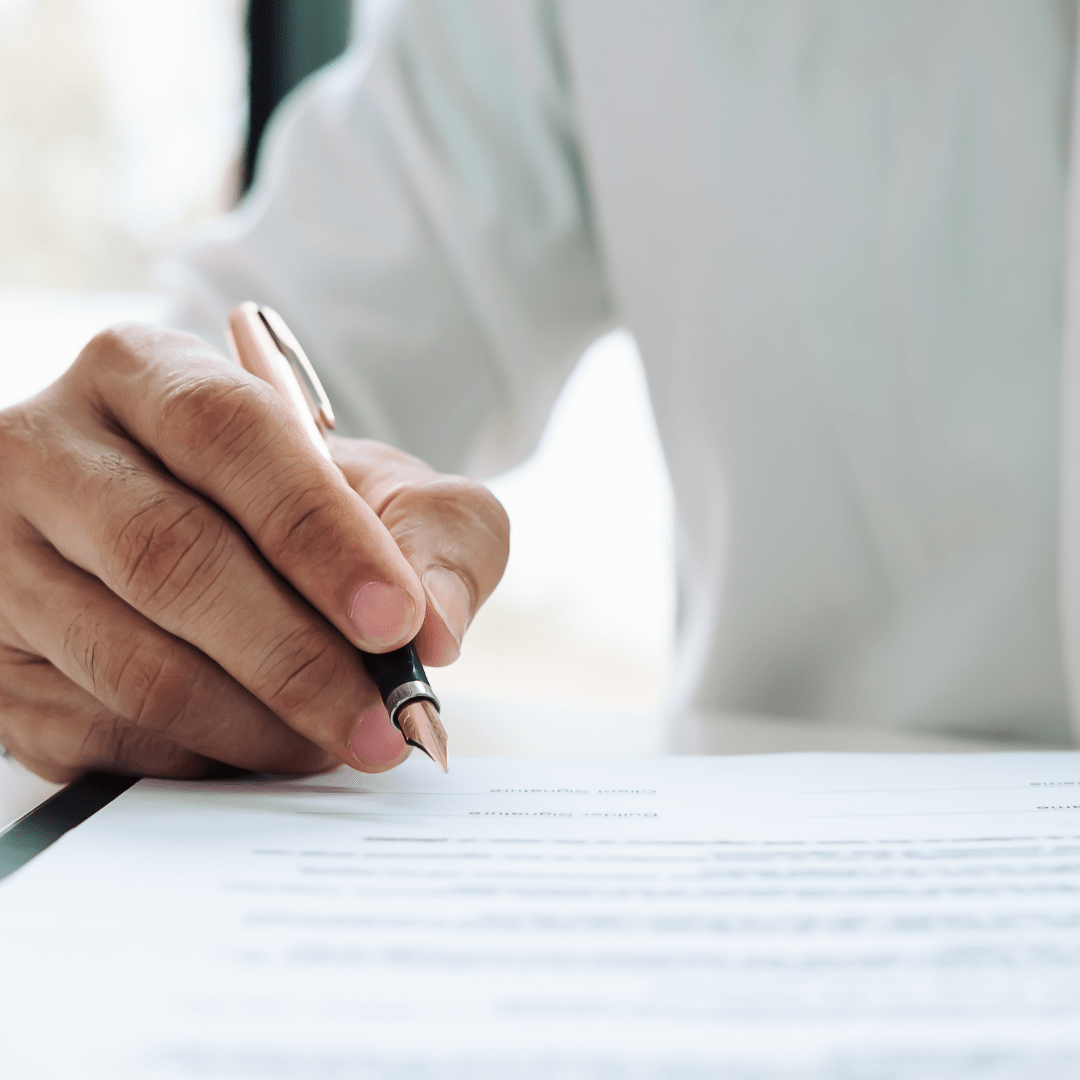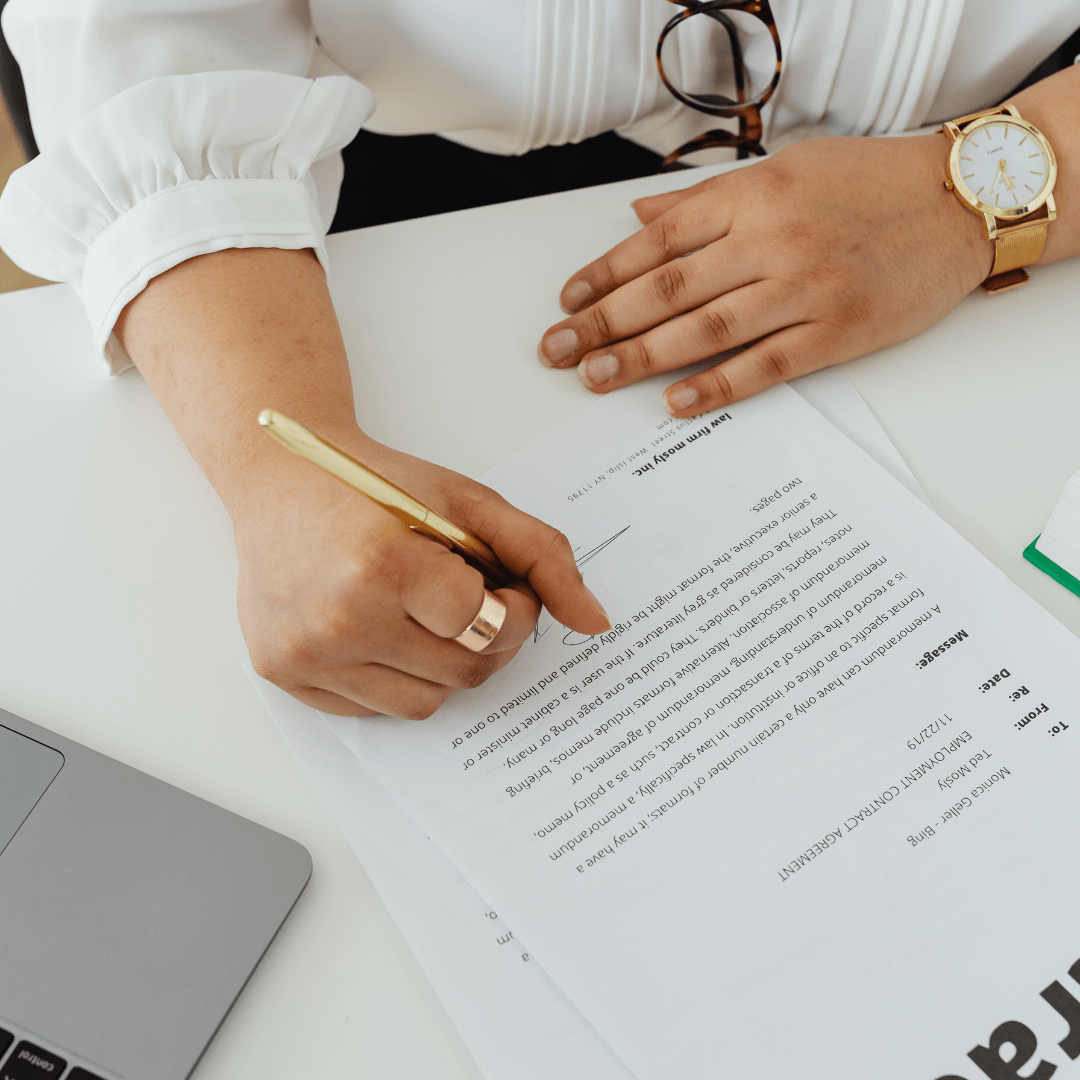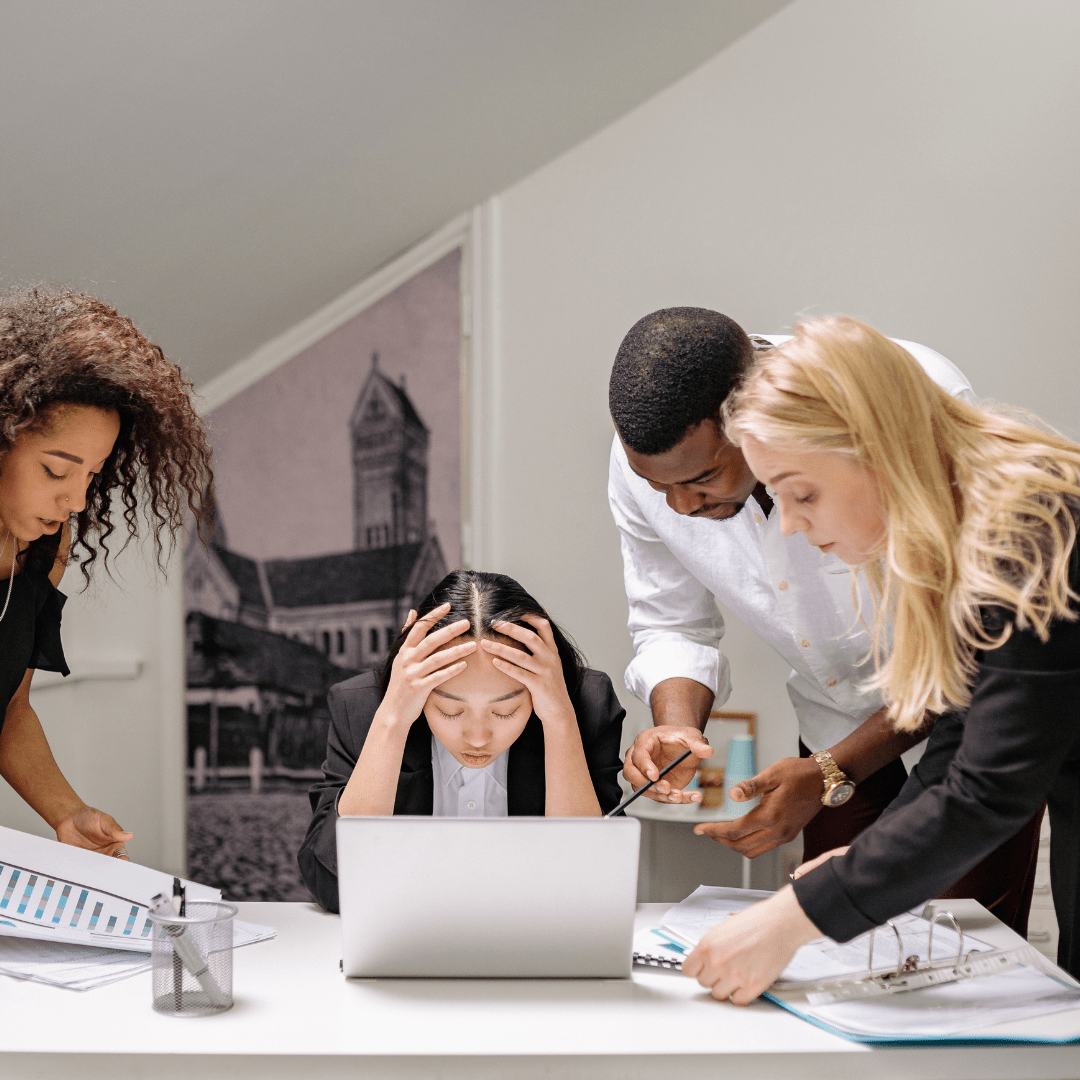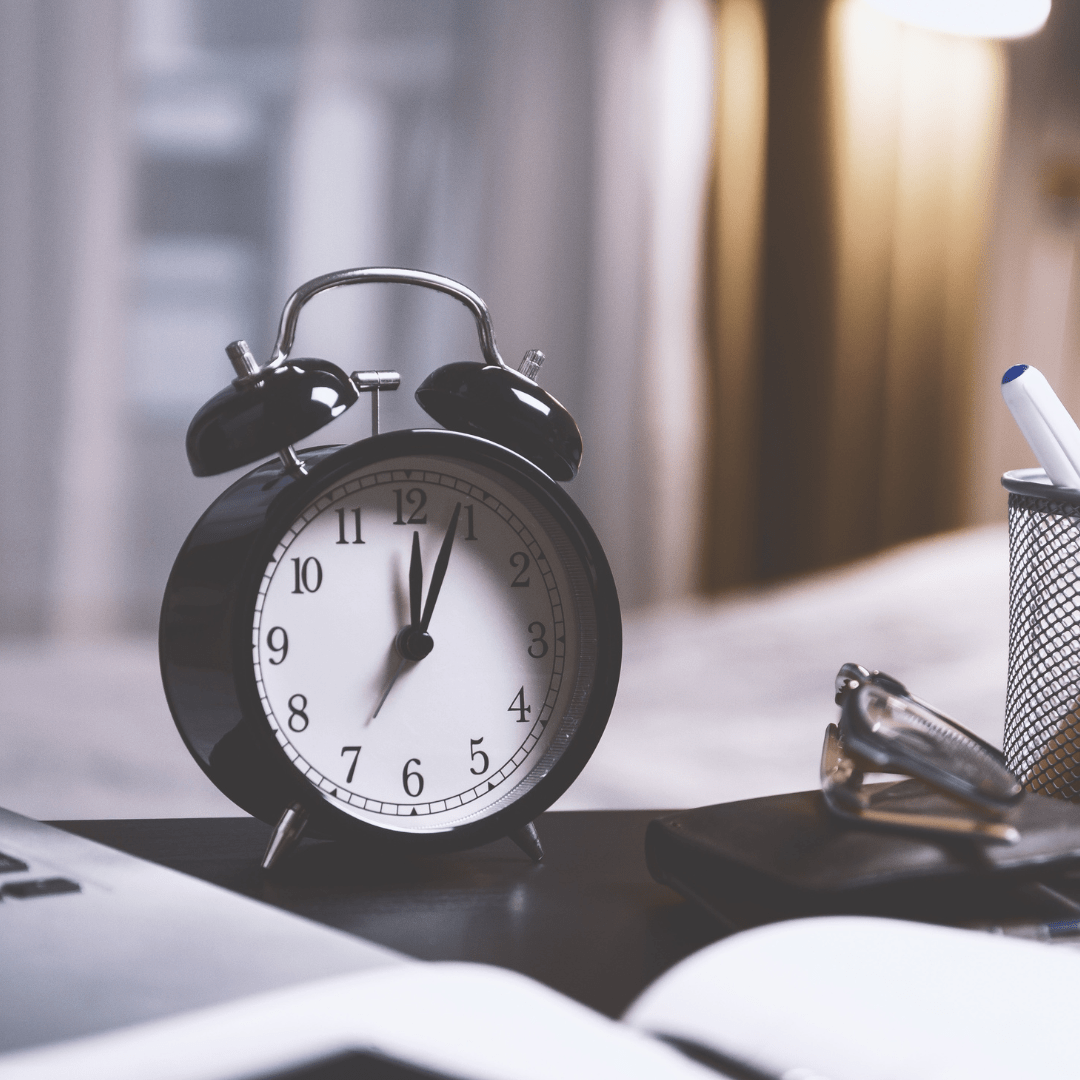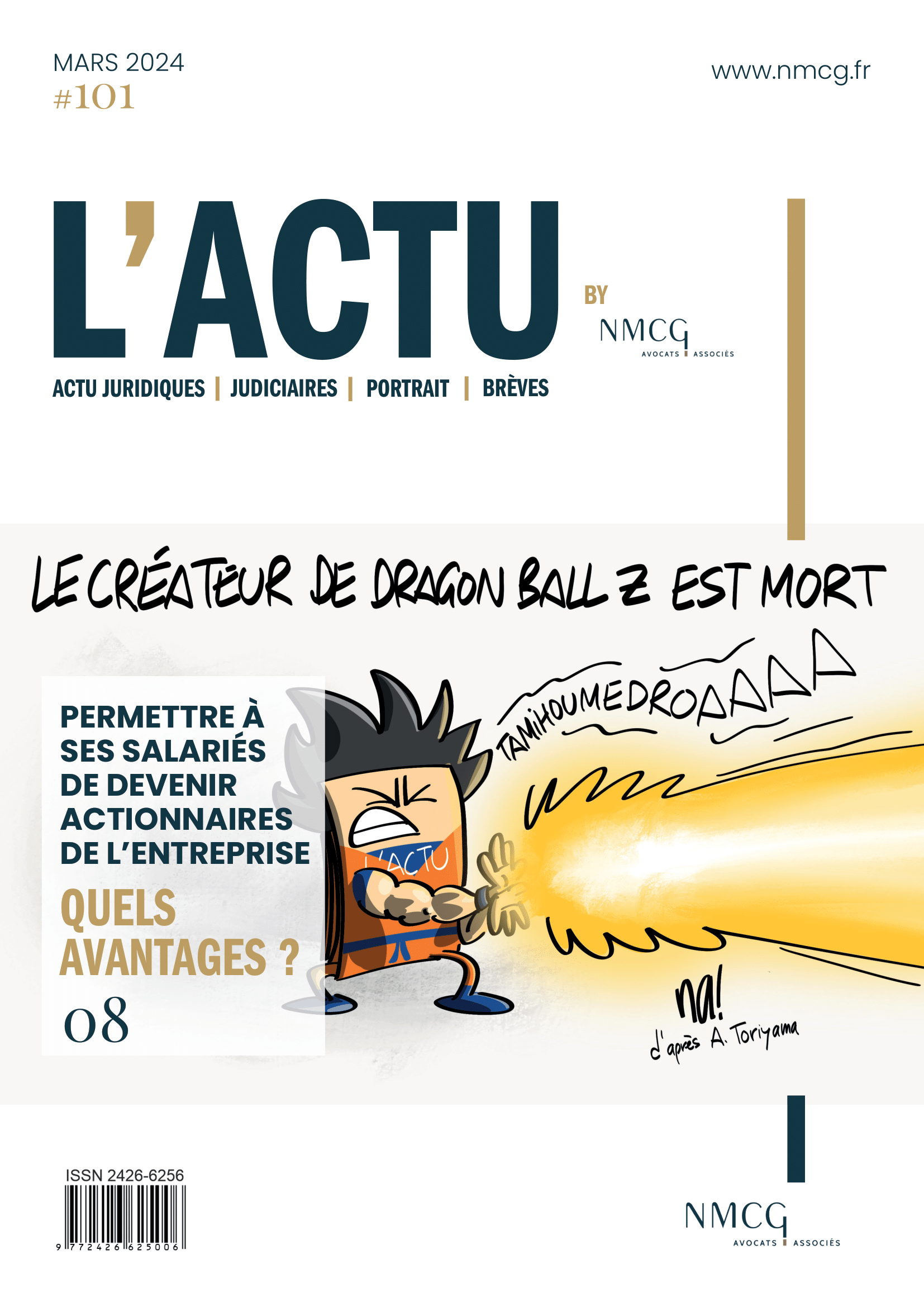Nos actualités
Les nouveautés
Suivez les actualités du cabinet d'avocats NMCG
Toutes les actualités
Bureau

Tous
Paris
Nantes
Nice
Strasbourg
La Colle-sur-Loup
Auteur

Tous
Arnaud BLANC DE LA NAULTE
Laurent COURTECUISSE
Sonia ABODJA
Thomas MÉLEN
Lauren SIGLER-CHAIN
Bernardine TYL-GAILLARD
Cyril CHABERT
Frédéric LEVADE
Vaea PERY
Claire PEROUX
Olivier CASTELLACCI
Charlotte SOUCI-GUEDJ
Valérie Reynaud
Expertise

Tous
Droit pénal du travail
Contentieux individuels et collectifs
Contentieux des affaires
Droit public - Regulatory
Droit pénal des affaires
Droit immobilier
Droit de la santé
Economie du sport
Arbitrage national et international
Droit de la logistique et du transport
E-commerce
Droit des nouvelles technologies et économie numérique
Droit de la propriété intellectuelle
Droit bancaire - Droit financier
Droit de la concurrence et de la distribution
Droit commercial - Droit des contrats
Restructurations
Droit fiscal
Corporate - Fusions & Acquisitions
Droit du travail et de la protection sociale