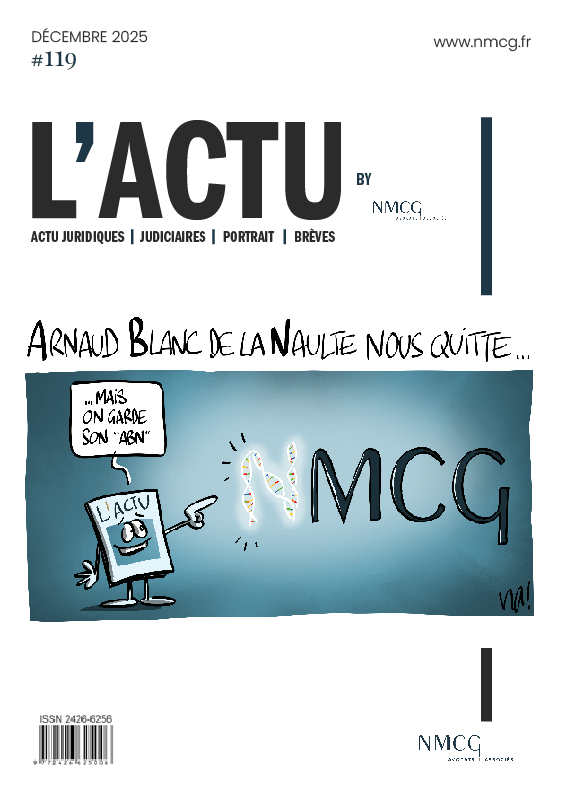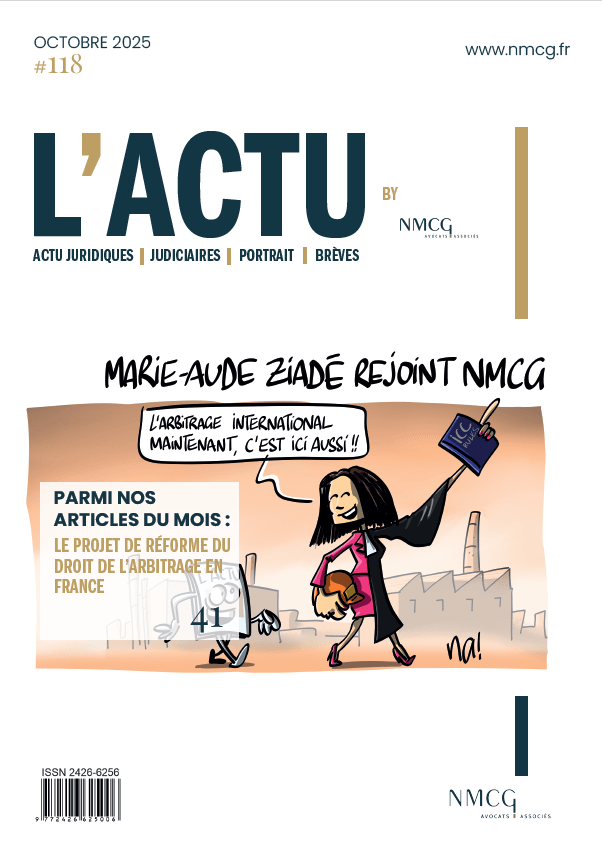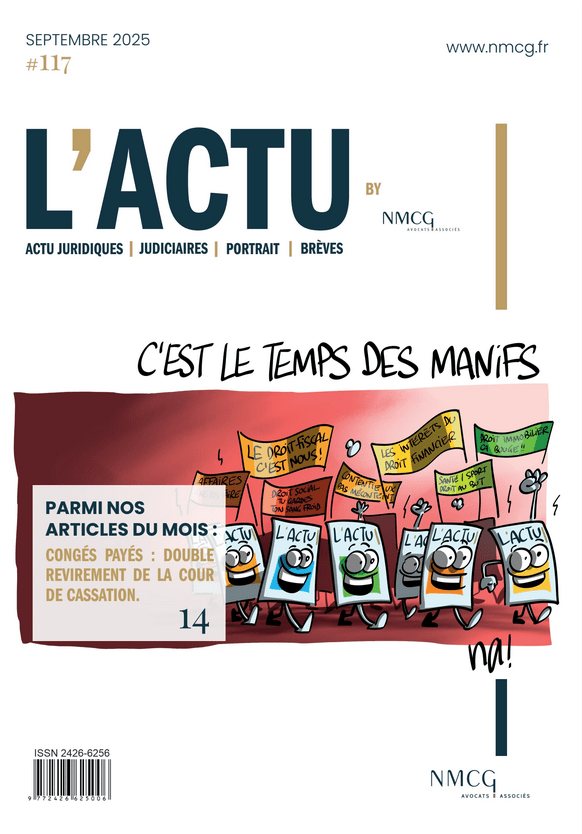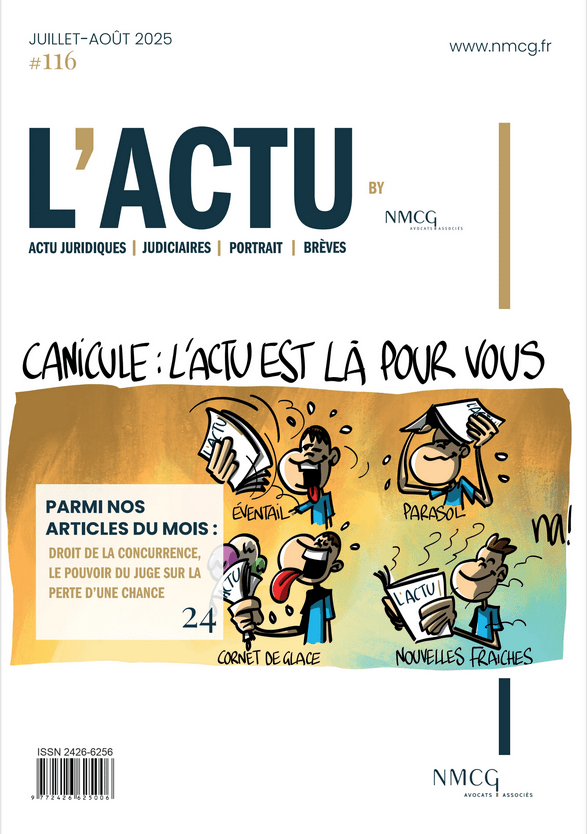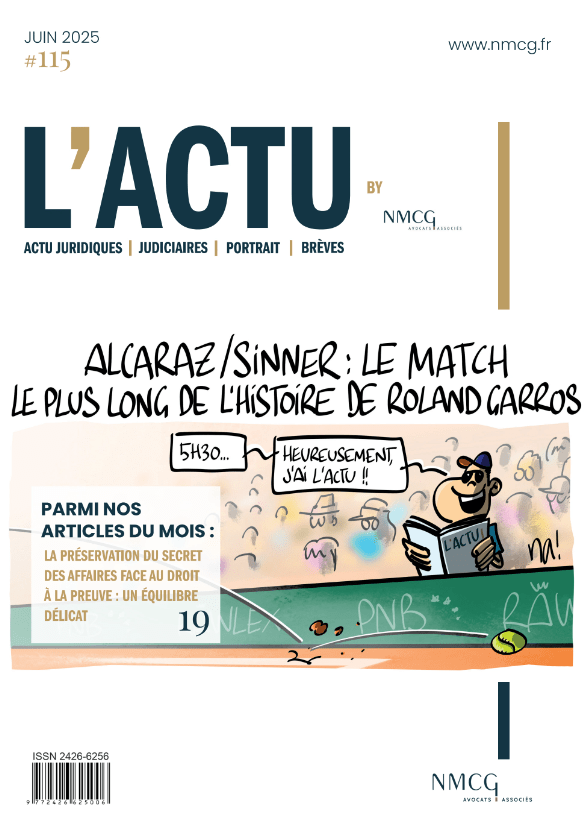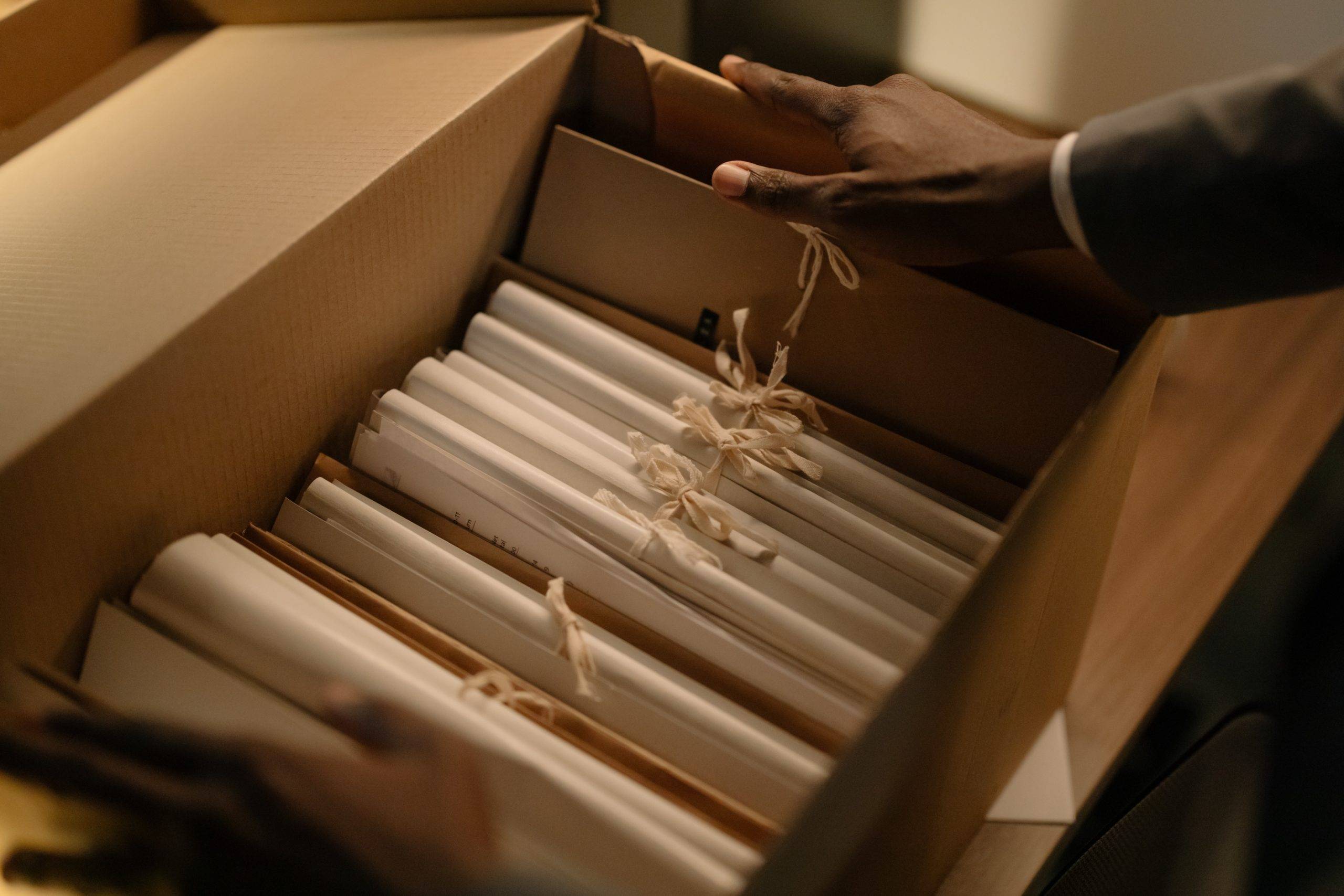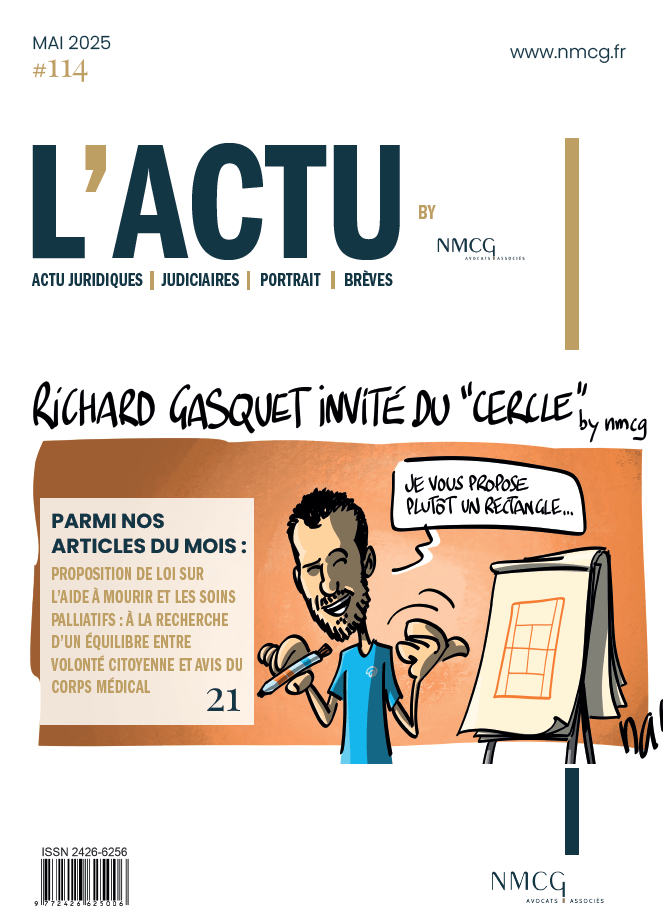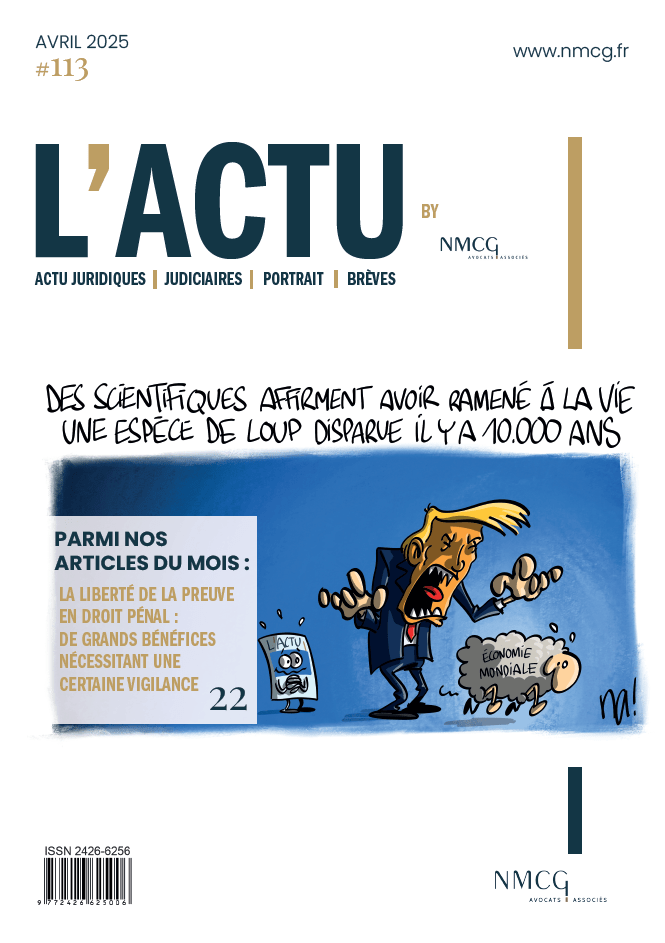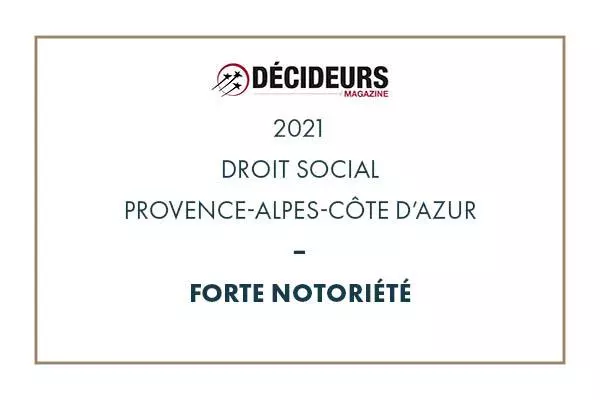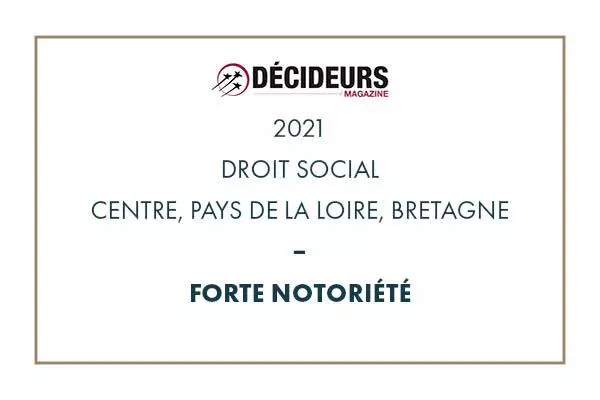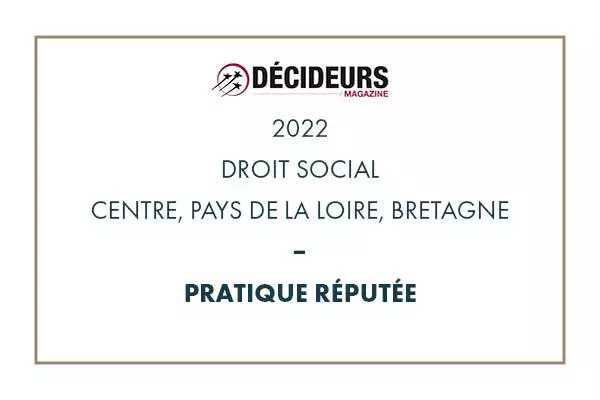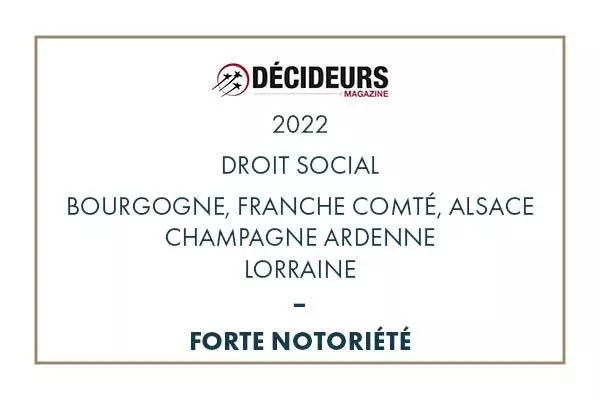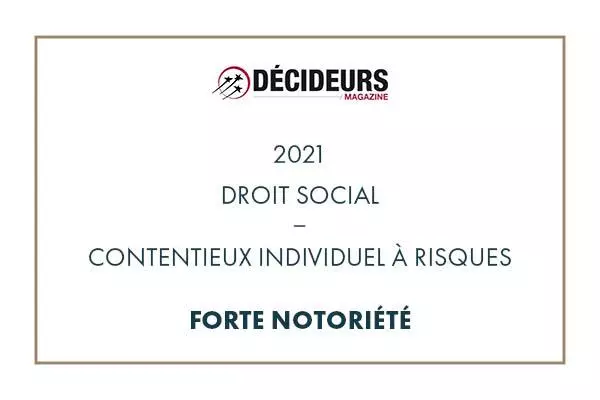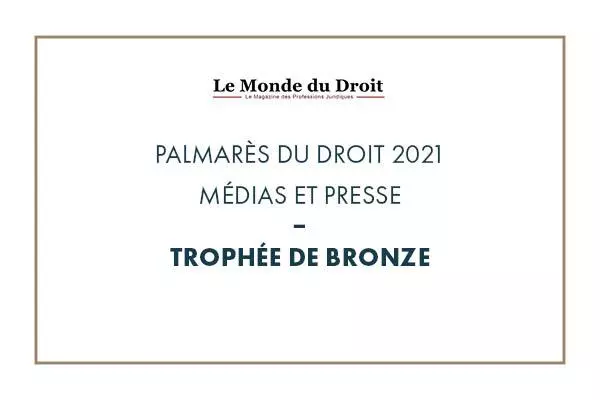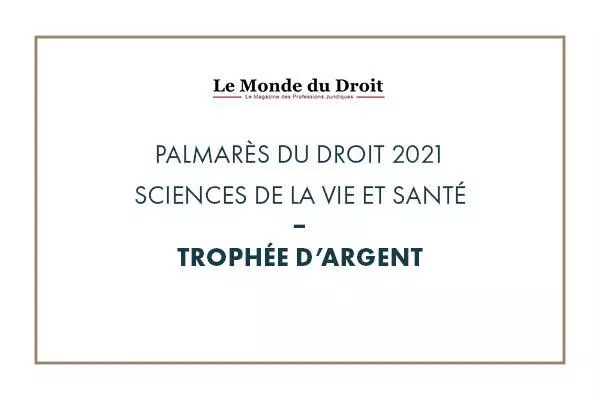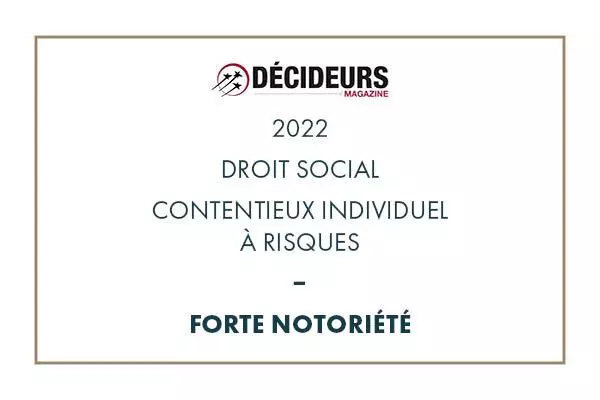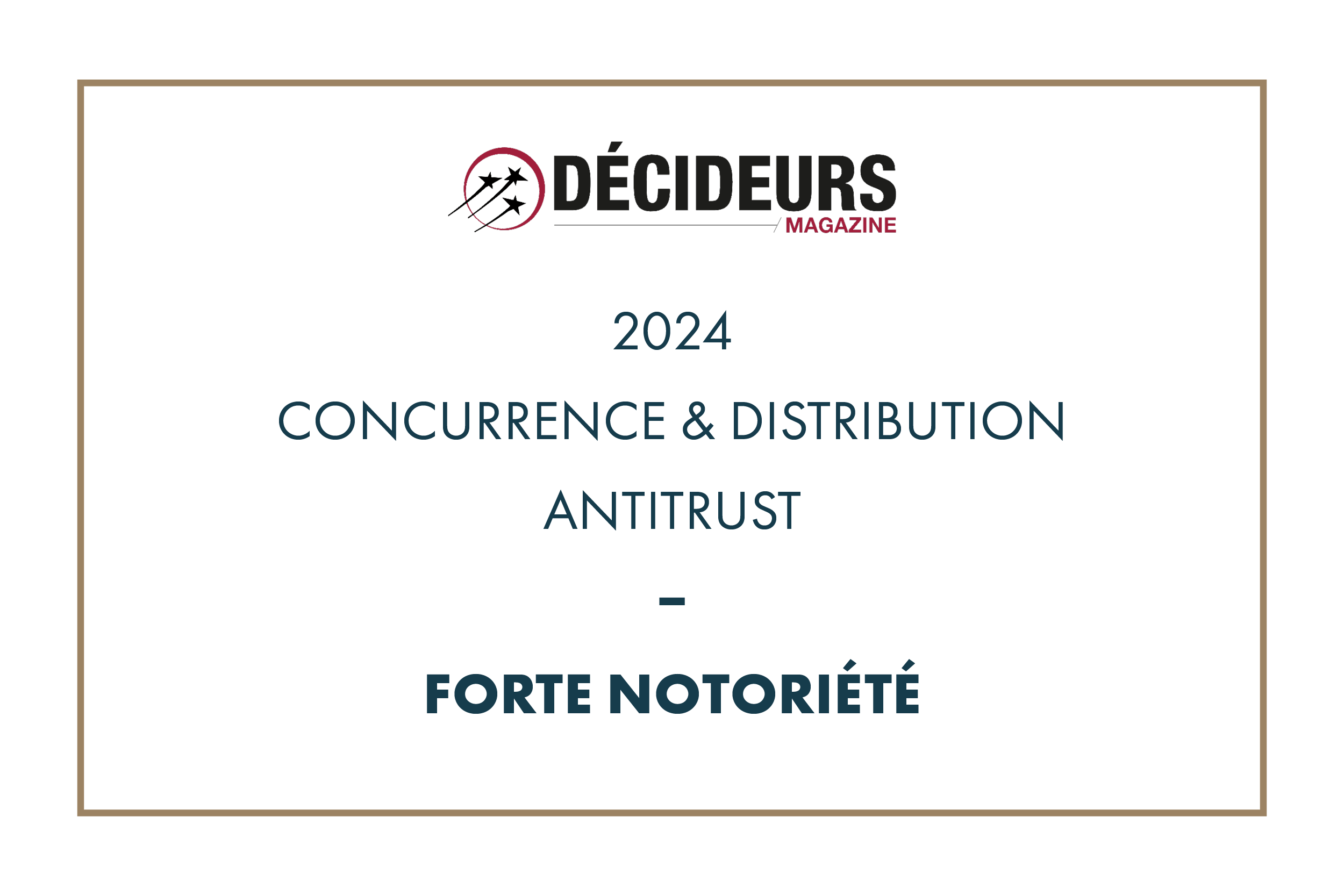Nullités en droit des sociétés : la grande réforme de 2025
29 avril 2025
Le régime des nullités en droit des sociétés a longtemps été critiqué pour sa complexité et les incertitudes qu’il engendrait, notamment en raison des risques de « nullités en cascade » pouvant fragiliser la stabilité des entreprises.
L’ordonnance du 12 mars 2025 intervient dans ce contexte pour apporter des solutions concrètes visant à sécuriser les décisions sociales et à harmoniser le droit français avec les standards européens, notamment la directive (UE) 2017/1132 du 14 juin 2017.
Ses dispositions entrerons en vigueur au 1er octobre 2025 (à l’exception de la sanction de la nullité des décisions collectives pour absence de désignation d’un auditeur des informations en matière de durabilité qui, elle, n’entrera en vigueur qu’au 1er janvier 2027).
Elles s’appliqueront donc aux actes sociaux passés avant le 1er octobre 2025
Sécurisation des décisions sociales et limitation des nullités
-
Introduction d’un « triple test » pour le prononcé des nullités
Avant la réforme, toute violation d’une disposition impérative du droit des sociétés pouvait entraîner automatiquement la nullité, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un grief ou une atteinte à l’intérêt social. (exemple : une irrégularité purement formelle dans une convocation d’assemblée pouvait suffire à annuler une décision… même si tous les associés étaient présents et d’accord).
L’une des innovations majeures de l’ordonnance est l’instauration d’un « triple test » destiné à encadrer le prononcé des nullités des décisions sociales.
Désormais, selon l’article 1844-12-1 du Code civil, pour qu’une nullité soit prononcée, trois conditions cumulatives doivent être remplies :
- Le demandeur doit justifier d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle violée.
- L’irrégularité doit avoir eu une influence sur le sens de la décision.
- Les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne doivent pas être excessives au regard de l’atteinte à l’intérêt protégé.
Ce mécanisme vise à éviter les annulations systématiques et à permettre une appréciation plus nuancée des situations, renforçant ainsi la stabilité des décisions prises au sein des sociétés.
Encadrement des effets des nullités pour prévenir les « nullités en cascade. »
Avant la réforme, une nullité pouvait entraîner d’autres nullités en chaîne, remettant en cause toute une série de décisions postérieures. (exemple : la nomination irrégulière d’un dirigeant pouvait remettre en cause toutes les décisions qu’il avait prises ensuite).
Cela créait une insécurité juridique majeure, notamment dans les sociétés avec une forte activité décisionnelle.
L’ordonnance introduit des dispositions spécifiques pour limiter les effets en chaîne des nullités.
Notamment, l’article 1844-15-1 du Code civil prévoit que, sauf disposition législative contraire, la nullité de la nomination ou du maintien irrégulier d’un organe ou d’un membre d’un organe de la société n’entraîne pas la nullité des décisions prises par celui-ci.
De plus, l’article 1844-15-2 permet au juge de différer les effets de la nullité lorsqu’une rétroactivité produirait des conséquences manifestement excessives pour l’intérêt social.
-
Réduction du délai de prescription des actions en nullité
Afin de favoriser une plus grande sécurité juridique, l’ordonnance réduit le délai de prescription des actions en nullité de trois à deux ans à compter du jour où la nullité est encourue. Cette modification incite les parties prenantes à agir plus promptement en cas d’irrégularité constatée.
2 – Simplification et clarification du régime des nullités
-
Unification des dispositions légales
Le régime des nullités était auparavant dispersé entre le Code civil et le Code de commerce, engendrant des redondances et des incertitudes. L’ordonnance restitue aux articles 1844-10 et suivants du Code civil leur fonction de droit commun en matière de nullités, tandis que les dispositions spécifiques aux restructurations et aux opérations sur le capital sont relocalisées dans le Code de commerce.
-
Clarification des causes de nullité
La réforme précise que la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés ou des causes de nullité des contrats en général.
Cette clarification remplace la précédente référence aux « actes et délibérations », offrant une meilleure lisibilité des textes et une application plus cohérente des règles.
-
Évolution du régime de nullité pour violation des statuts
L’ordonnance pose le principe selon lequel, sauf disposition législative contraire, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité.
Cependant, une exception notable est introduite pour les sociétés par actions simplifiées (SAS) : les statuts peuvent prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu’ils établissent. Cette faculté permet aux associés de renforcer l’effectivité des clauses statutaires en y attachant une sanction spécifique.
***
L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 apporte des modifications substantielles au régime des nullités en droit des sociétés, avec pour objectif principal de renforcer la sécurité juridique et de prévenir les effets déstabilisateurs des annulations de décisions sociales.
En introduisant un contrôle judiciaire plus strict, en encadrant les effets des nullités et en clarifiant les causes d’annulation, cette réforme harmonise le droit français avec les standards européens et répond aux attentes des praticiens et des entreprises.