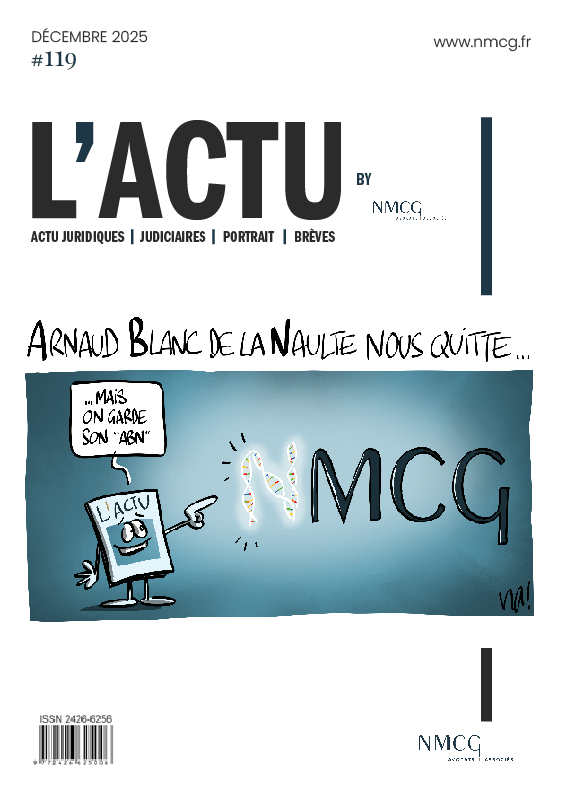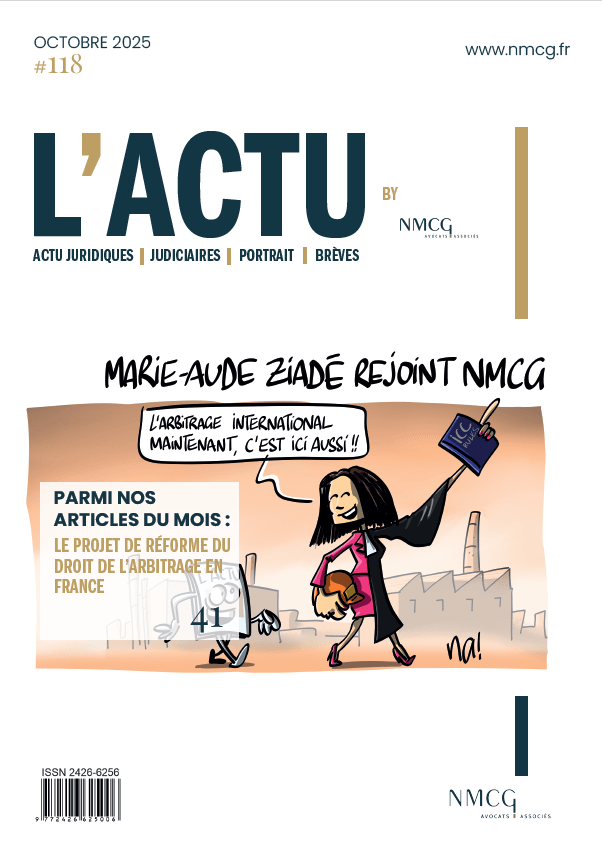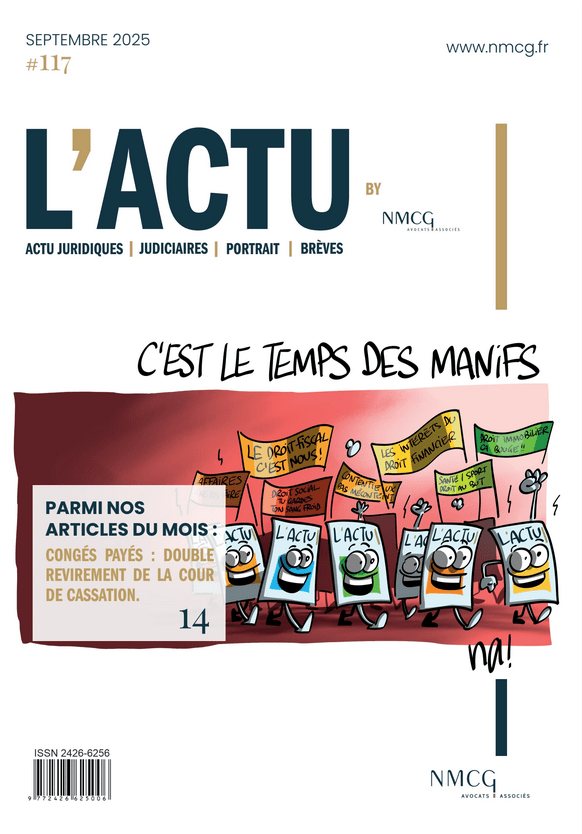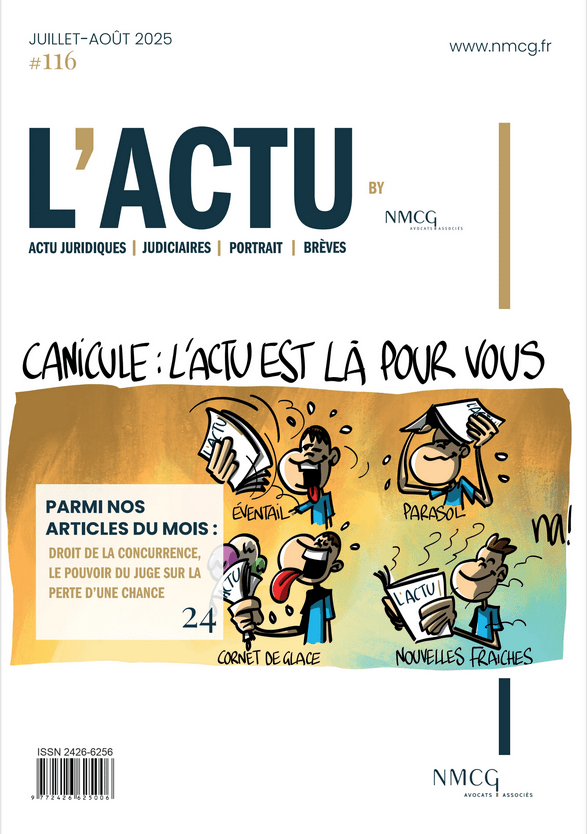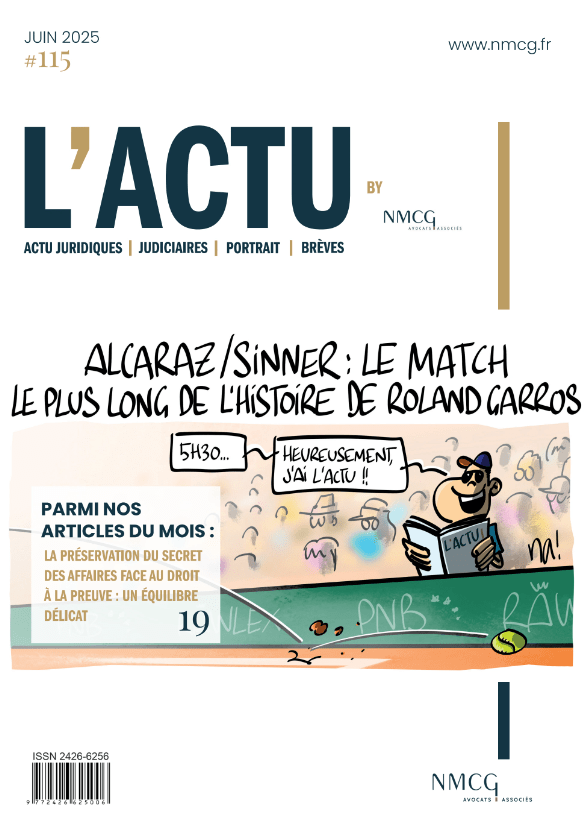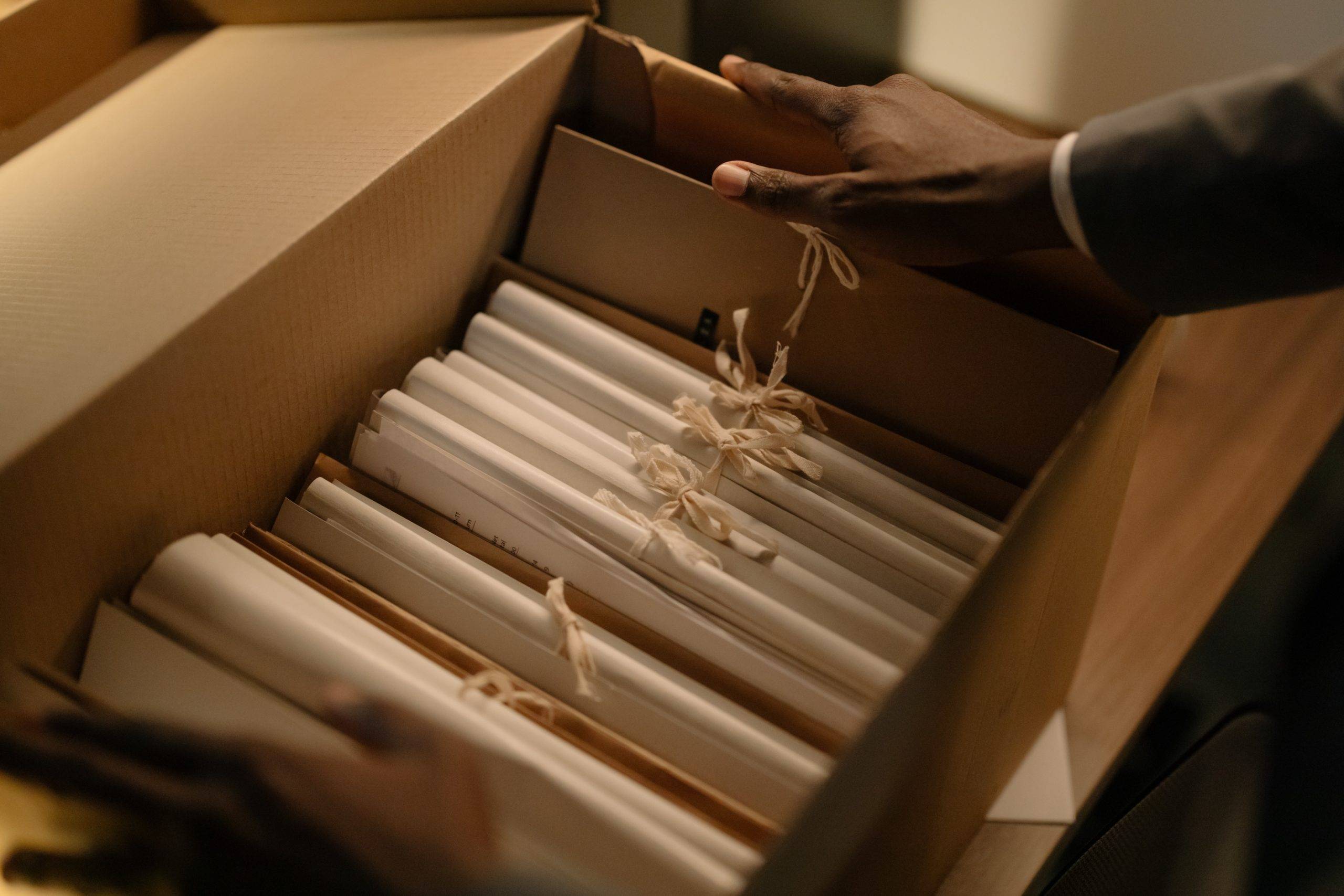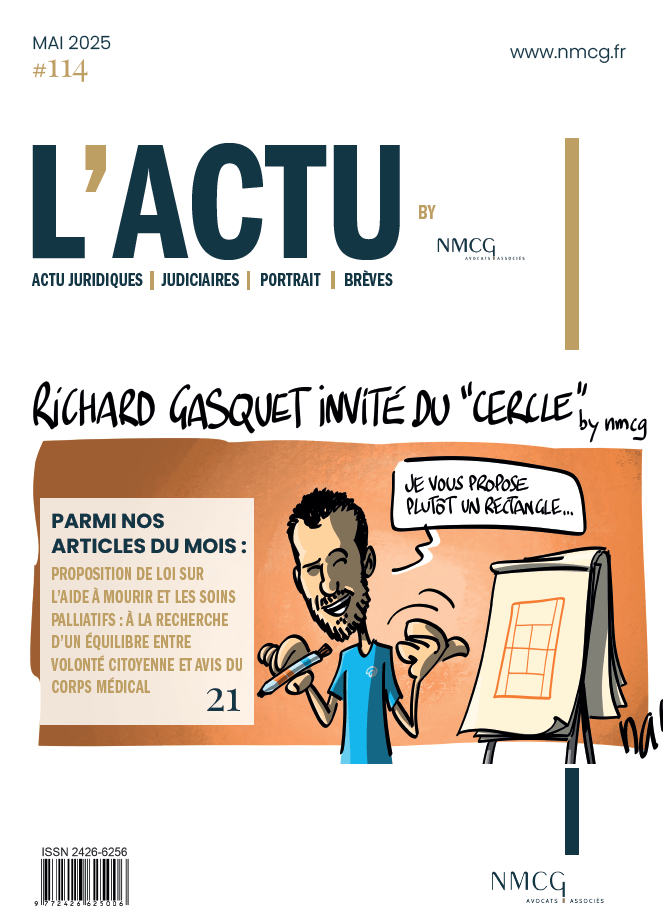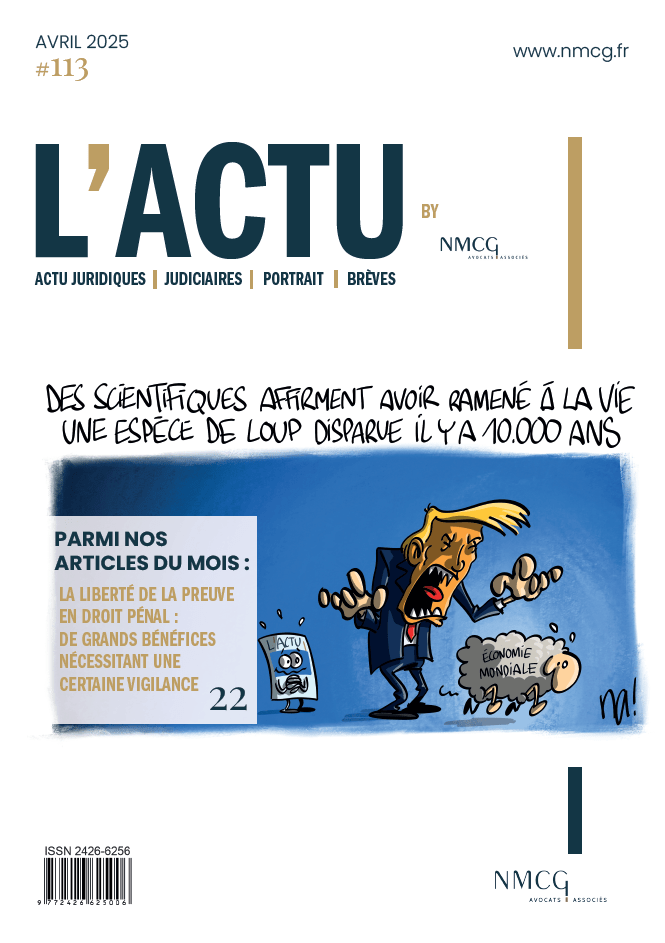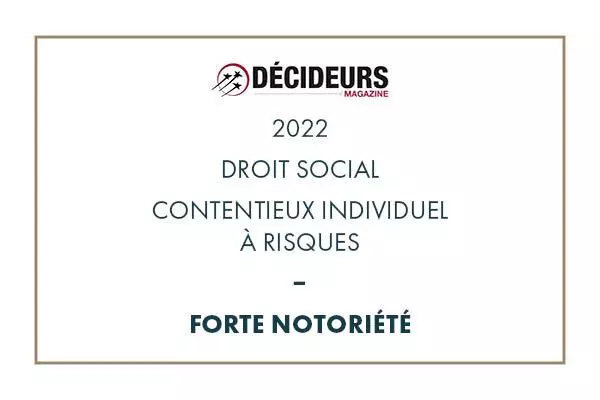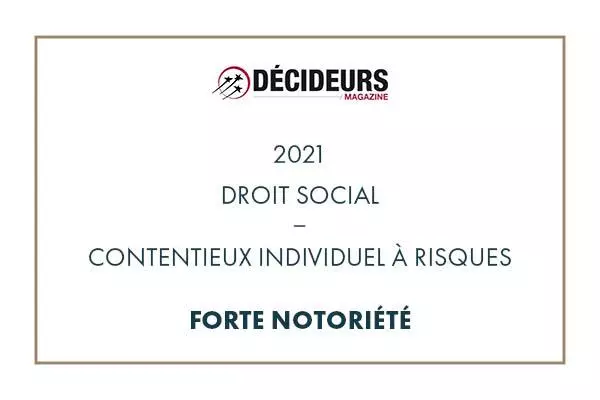Une autorisation de licenciement devenue définitive n’est pas toujours suffisante…
29 avril 2025
Cass. soc., 26 mars 2025, n°23-12.790
Depuis de nombreuses années, la Cour de cassation rappelle régulièrement que : « le juge judiciaire ne peut, en l’état de l’autorisation administrative de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement ; il reste, cependant, compétent pour apprécier les fautes commises par l’employeur pendant la période antérieure » (Cass. soc., 10 février 1999, n°95-43.561 ; Cass. soc., 8 février 2012, n°10-18.957 ; Cass. soc., 5 décembre 2012, n°10-20.584 ; Cass. soc., 1er juin 2023, n°21-19.649 ; Cass. soc., 17 janvier 2024, n°22-20.778 ; Cass. soc., 26 mars 2025, n°23-12.790).
Ainsi, dans deux arrêts, la Haute Cour a retenu qu’un salarié protégé dont le licenciement avait été autorisé par l’inspection du travail ne pouvait plus contester la validité de ce dernier sur le fondement d’un manquement de l’employeur à ses obligations (Cass. soc., 5 décembre 2012, n°10-20.584 – rendu en matière d’inaptitude ; Cass. soc., 17 janvier 2024, n°22-20.778 – rendu en matière de discrimination).
Toutefois un arrêt récent (Cass. soc., 26 mars 2025, n°23-12.790) appelle à la plus grande prudence s’agissant de l’interprétation de la portée de ces arrêts. Il semble ainsi que cette solution ne soit pas toujours applicable.
Sur les faits :
Dans cette affaire, un salarié, représentant de section syndicale, a été licencié pour motif économique le 13 juin 2013, après autorisation de l’inspecteur du travail du 10 juin précédent.
Le salarié a contesté la décision d’autorisation, laquelle a toutefois été confirmée par la Cour administrative d’appel saisie de ce dossier par un arrêt du 13 juin 2017.
Entre temps, les procédures administratives étant (hélas) très longues, le 10 juin 2014, 11 mois après la rupture autorisée de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes pour notamment solliciter du conseil qu’il juge nul son licenciement.
Au soutien de cette demande il a invoqué deux motifs :
- Il a reproché à la société de ne pas avoir organisé de visite de reprise après un après un arrêt de travail pour accident du travail d’une durée de 6 mois, en méconnaissance des dispositions légales applicables. Dès lors, son licenciement était nul puisque celui-ci était intervenu en violation des dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail.
- Il a considéré que l’employeur avait méconnu les critères d’ordre de licenciement.
Par jugement en départage du 10 mars 2020, le Conseil de prud’hommes a « déclaré sa compétence pour examiner l’action du salarié dans son ensemble » et l’a débouté de nombre de ses demandes notamment celles afférentes à la nullité de la rupture du contrat de travail.
Insatisfaits de cette décision le salarié, et le syndicat qui est intervenu à l’instance, ont interjeté appel de ce jugement.
En cause d’appel, le jugement a été confirmé et le salarié a de nouveau été débouté de ses demandes relatives à la nullité de la rupture.
La Cour d’appel a retenu qu’il ne démontrait pas qu’il avait été placé en arrêt de travail pendant une durée supérieure à 30 jours pour accident du travail (condition prévue par l’article R.4624-22 du Code du travail dans sa version applicable à compter du 1er juillet 2012 et jusqu’au 1er janvier 2017 pour l’organisation de la visite de reprise) et pouvait se prévaloir de la protection prévue par l’article L.1226-9 du Code du travail.
Par voie de conséquence, les juges en ont conclu que l’existence d’une obligation pour l’employeur d’organiser une visite de reprise n’était pas établie en premier lieu.
En second lieu, ils ont retenu que le moyen tiré de la violation des critères d’ordre était inopérant.
La société a pour sa part soutenu une fin de non-recevoir sur laquelle l’arrêt est toutefois resté muet.
Le salarié a formé un pourvoi en cassation.
Sur la portée de la décision :
La Cour de cassation s’est tout d’abord prononcée sur le second moyen invoqué par la société dans son pourvoi incident.
Comme vu ci-avant, la société a en effet fait grief à l’arrêt de la débouter de sa fin de non-recevoir fondée sur l’irrecevabilité de la demande de nullité du licenciement en raison de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour administrative d’appel du 13 juin 2017, sans répondre précisément dans son arrêt à ce moyen.
Elle en concluait que la cour d’appel avait violé l’article 455 du Code de procédure civile.
Dans sa décision, la Cour de cassation y répondait, jugeant que l’arrêt n’encourait pas la cassation puisque : « si le juge judiciaire ne peut, en l’état de l’autorisation administrative accordée à l’employeur de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste, cependant, compétent pour apprécier les fautes commises par l’employeur pendant la période antérieure au licenciement et notamment le non-respect par l’employeur des dispositions des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du Code du travail en l’absence de visite de reprise après l’arrêt de travail pour cause d’accident du travail. »
La solution n’est pas étonnante. Comme évoqué ci-avant, la Cour de cassation juge de longue date que le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur les manquements commis par l’employeur pendant la période antérieure à la rupture du contrat de travail.
Le second point tranché par la Cour est le premier moyen du pourvoi principal du salarié, qui est dans la suite de ce qui précède.
Le salarié a fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes car selon lui le juge devait trancher le litige et notamment vérifier si la société n’était pas tenue d’organiser une visite médicale de reprise au regard des dispositions légales applicables à la date de survenance de son accident de travail.
A nouveau la solution n’étonne pas, la Cour rappelle que les juges du fond auraient dû vérifier si la société avait effectivement respecté ses obligations s’agissant de l’organisation d’une visite de reprise après un arrêt de travail pour accident du travail, au regard des dispositions de l’article R.4624-21, 3e, du Code du travail, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er juillet 2012, applicable au litige.
C’est en réalité la portée de cet arrêt qui dénote. Et pour cause, la Haute Cour « casse et annule (l’arrêt), mais seulement en ce qu’il déboute (le salarié) de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes ». Elle « remet, sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel autrement composée ».
Les formulations précitées laissent à penser que le salarié pourrait donc obtenir la nullité de son licenciement par devant la juridiction de renvoi, en parfaite contradiction avec le principe de l’autorité de la chose jugée.
Pourtant dans une décision très récente rendue en matière de discrimination syndicale la Cour de cassation a précisé qu’en application du principe de séparation des pouvoirs le salarié ne pouvait obtenir l’annulation de son licenciement pour motif économique, autorisé par l’inspection du travail, quand bien même des faits de discrimination seraient établis (Cass. soc., 17 janvier 2024, n°22-20.778).
Cela n’empêche pas le salarié d’obtenir des dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant de ladite discrimination.
Attention toutefois, dans cette affaire spécifique, et ainsi que le relève la Cour dans son arrêt, l’inspection du travail avait dans sa décision d’autorisation du licenciement expressément relevé « l’absence de lien entre la demande d’autorisation de licenciement et le mandat exercé par le salarié ».
Au cas particulier, si aucune mention dans la décision administrative ou l’arrêt de la cour administrative d’appel ne permet de considérer que la cause de nullité invoqué par le salarié a déjà été jugée, les juges de la cour d’appel de renvoi pourraient envisager d’écarter l’autorité de la chose jugée attribuée à l’arrêt de la cour administrative d’appel et prononcer la nullité du licenciement.
Avec des conséquences lourdes pour l’employeur puisqu’une demande de réintégration, après plusieurs années, avec demande de rappel de salaire serait alors ouverte.
Si l’on entend la logique de la théorie juridique sur ce point, il serait de bon ton, nous ne cessons de l’évoquer, qu’une réforme utile et de bon sens intervienne en matière de protection des salariés protégés, tant elle est source de complexité, d’incertitudes, de contradictions, et de risques importants.
Notre autre arrêt commenté dans l’Actu de ce mois en est une nouvelle démonstration.