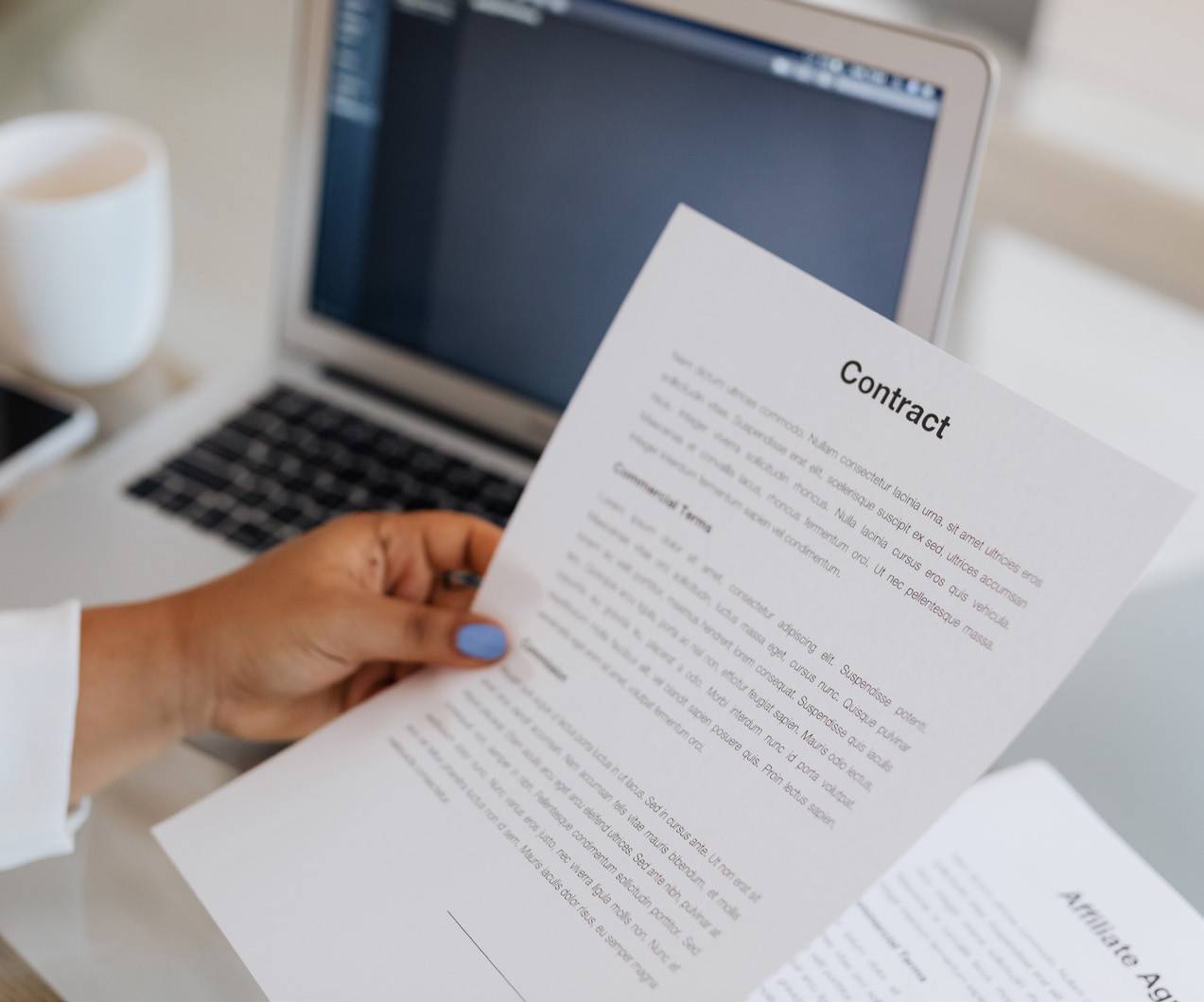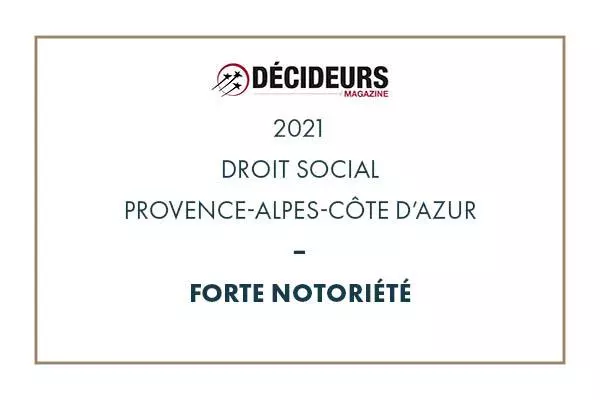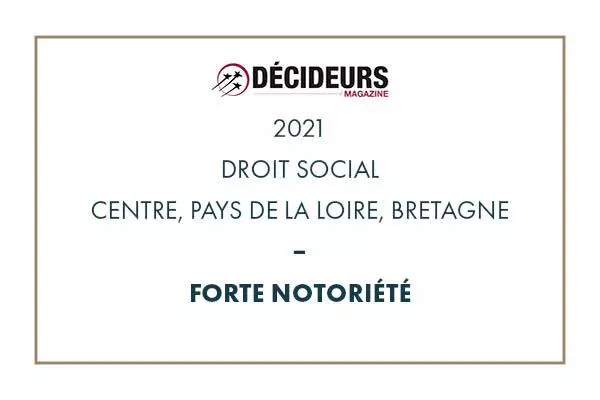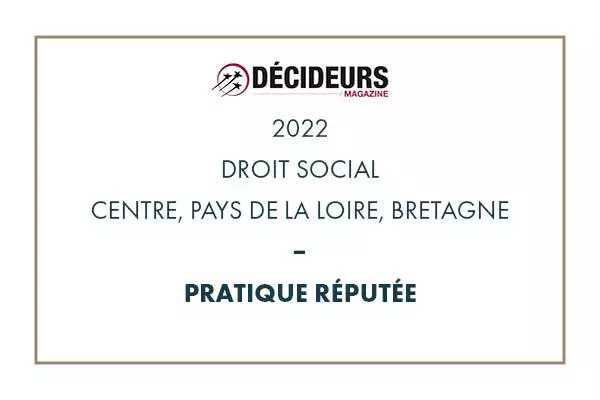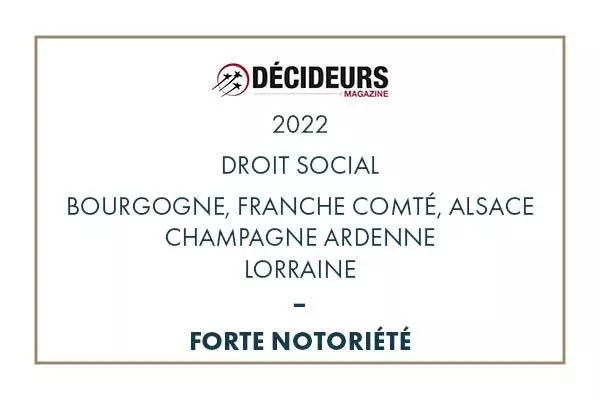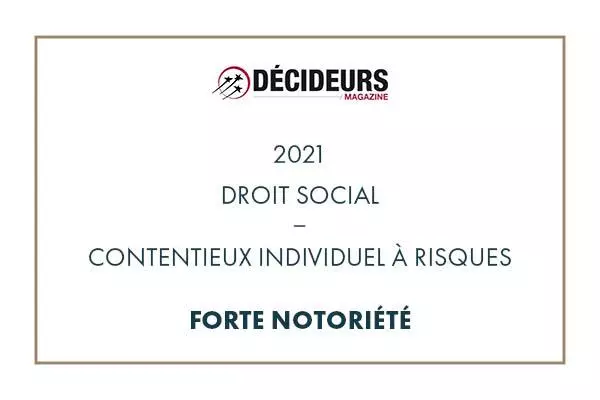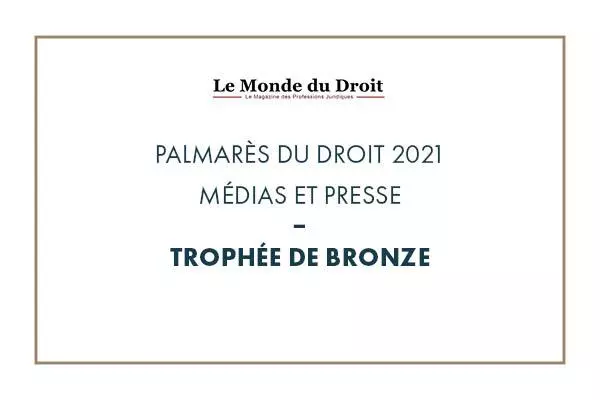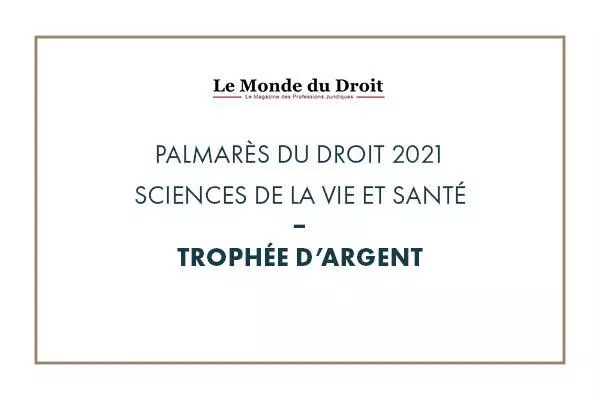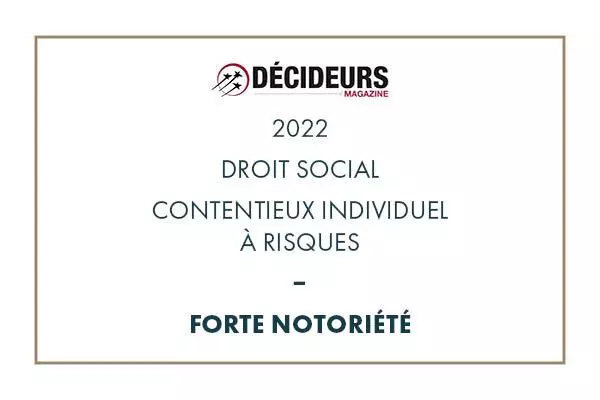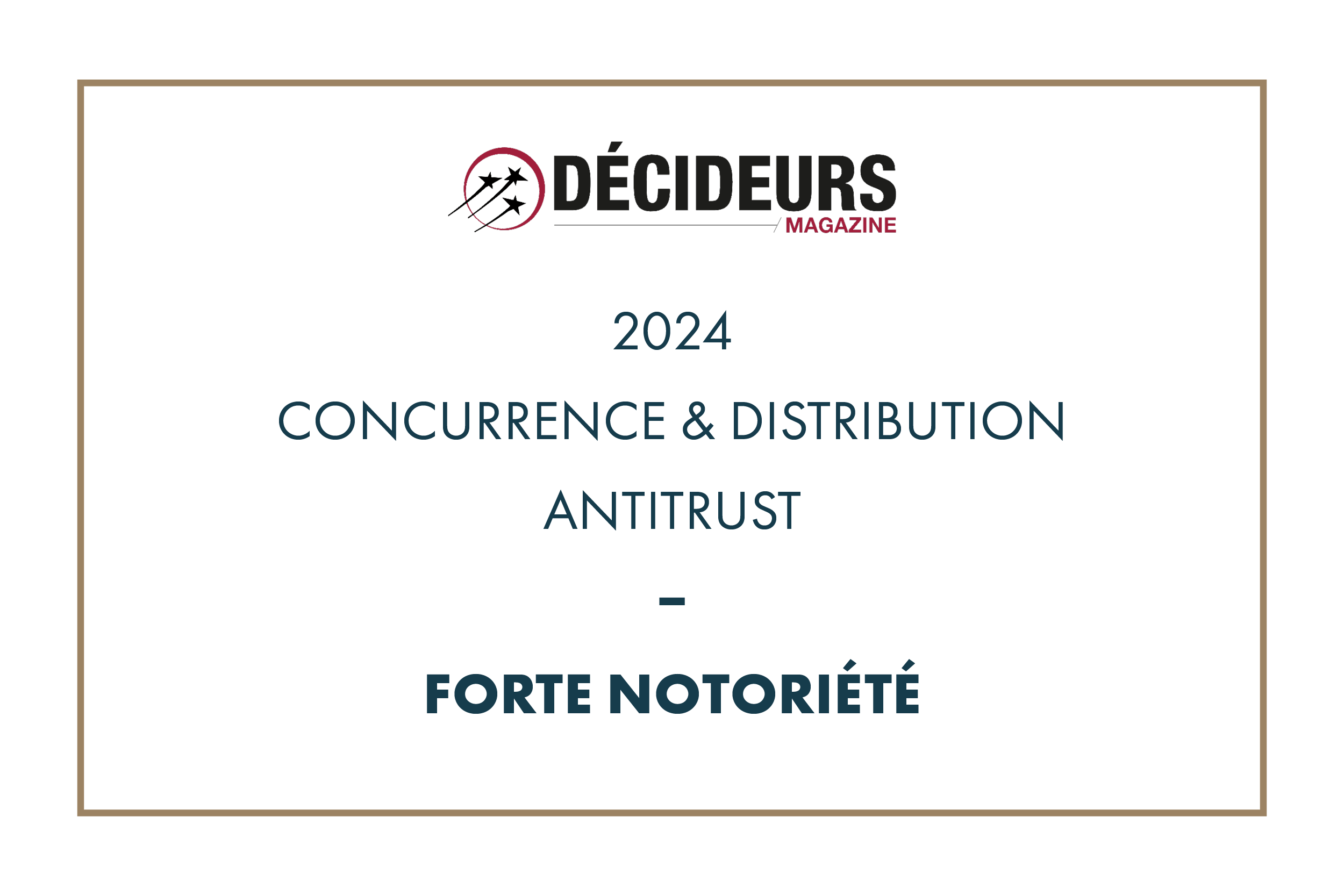Présomption de démission : premiers jalons jurisprudentiels pour un dispositif encore jeune
29 avril 2025
Deux décisions récentes – du Conseil d’État en décembre 2024, puis du conseil de prud’hommes de Lyon en février 2025 – viennent préciser la portée et les limites du régime de présomption de démission introduit par la loi « Marché du travail ». Elles rappellent notamment que ce mécanisme, bien qu’encadré, ne saurait s’affranchir des règles fondamentales du droit du travail.
Le Conseil d’État valide le dispositif, sous réserve d’une information complète du salarié
(CE, 18 décembre 2024, n° 473640 et autres, Association Le Cercle Lafay)
Dans une décision rendue quatre mois après l’entrée en vigueur du décret du 17 avril 2023, le Conseil d’État a rejeté plusieurs recours en annulation émanant de syndicats et d’associations d’employeurs. Il confirme la légalité du dispositif de présomption de démission, tout en exigeant des garanties précises dans sa mise en œuvre.
Le juge administratif insiste en particulier sur l’importance de la mise en demeure adressée au salarié, qui doit mentionner clairement les conséquences d’une absence de réponse ou de non-reprise du travail. Il ne suffit pas de rappeler le délai de 15 jours : l’employeur doit informer le salarié qu’à défaut de justification ou de retour, il sera présumé démissionnaire, avec une rupture du contrat à la clé.
👉 Conseil pratique : il est fortement recommandé d’indiquer dans ce courrier les effets concrets d’une démission présumée, notamment l’absence d’indemnités de rupture, la non-ouverture des droits au chômage, et les conséquences éventuelles en matière de préavis.
Enfin, le Conseil d’État écarte les arguments fondés sur le droit international, rappelant que la rupture ne procède pas d’une décision unilatérale de l’employeur, mais du comportement du salarié qui persiste dans son absence sans motif légitime.
Le conseil de prud’hommes de Lyon requalifie une présomption de démission en licenciement injustifié
(CPH Lyon, 21 février 2025, n° 23/02471)
Dans une affaire emblématique, le conseil de prud’hommes de Lyon a requalifié une rupture fondée sur la présomption de démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. En cause : une salariée ayant refusé une nouvelle affectation sur un site géré par une société tierce. Estimant qu’il s’agissait d’une mise à disposition et ainsi d’une modification unilatérale de son contrat de travail, elle a cessé de se présenter à son poste.
L’employeur a alors enclenché la procédure de présomption de démission, considérant qu’il s’agissait d’un abandon de poste volontaire. Mais pour les juges, la salariée était fondée à refuser cette affectation, dès lors qu’elle avait pour effet de modifier ses conditions de travail.
👉 Cette décision rappelle avec force que la présomption de démission ne peut pas servir à contourner les règles classiques encadrant les modifications contractuelles. Elle ne dispense pas non plus d’apprécier l’origine de l’absence et son imputabilité. Le simple fait que l’employeur ait suivi la procédure formelle ne suffit pas à valider la rupture.
En l’espèce, le conseil a estimé que la salariée pouvait légitimement invoquer un motif légitime d’absence, ce qui faisait obstacle à l’application de la présomption. Il a donc requalifié la rupture, avec versement des indemnités correspondantes.
À retenir pour les employeurs : vigilance sur la forme… et le fond
Ces deux décisions convergent sur un message essentiel : la présomption de démission ne saurait exonérer l’employeur de toute prudence juridique, ni servir de raccourci pour écarter un salarié en dehors du cadre légal du licenciement.
👉 Sur la forme, la mise en demeure doit être parfaitement rédigée, mentionnant expressément les conséquences de l’inaction du salarié.
👉 Sur le fond, l’employeur doit s’assurer que l’absence n’a pas pour origine une situation litigieuse de son fait, notamment une modification unilatérale du contrat.
Dans un contexte encore récent et en cours de construction jurisprudentielle, ces premiers arrêts posent des jalons clairs : information, dialogue, et traçabilité restent les maîtres mots d’une mise en œuvre sécurisée du dispositif.