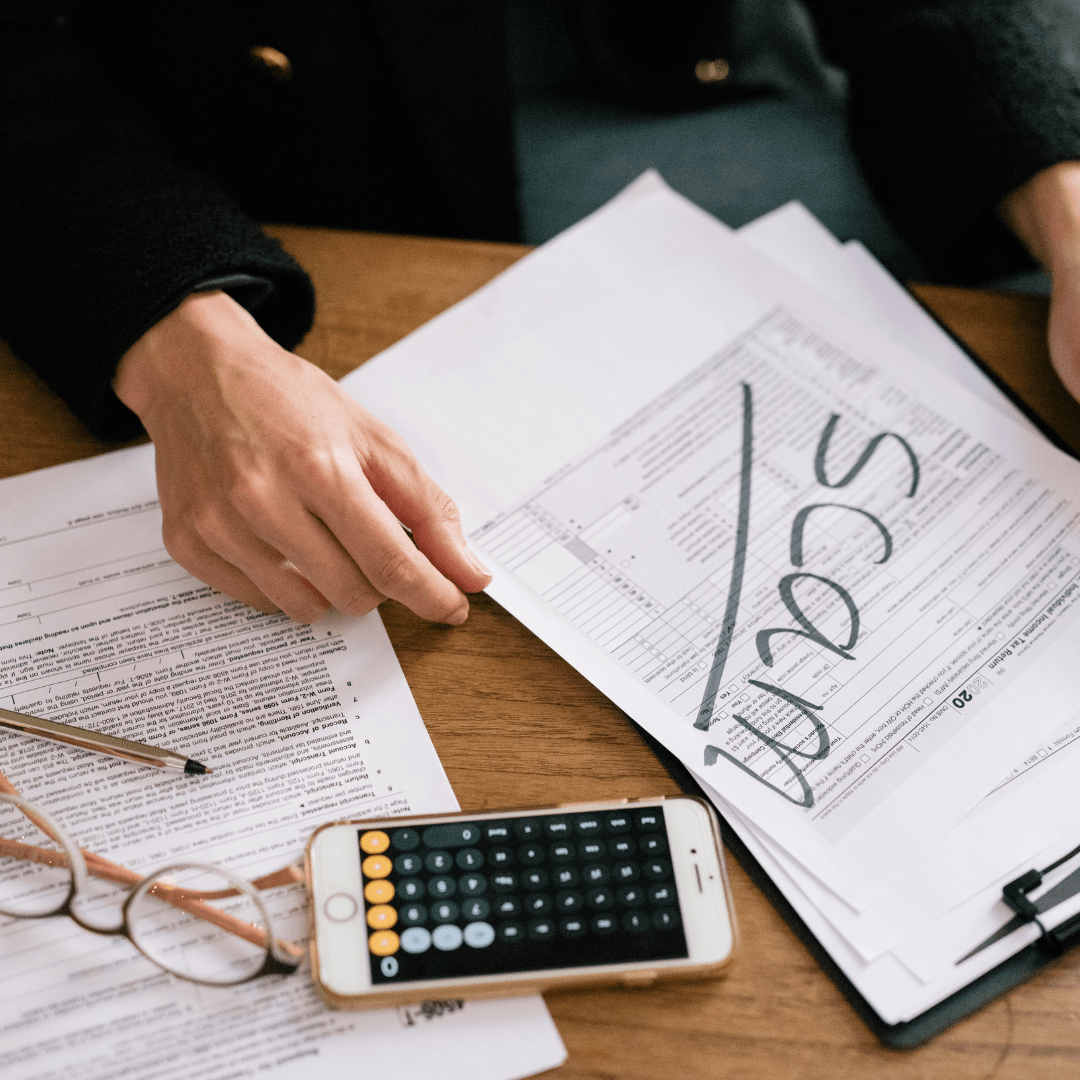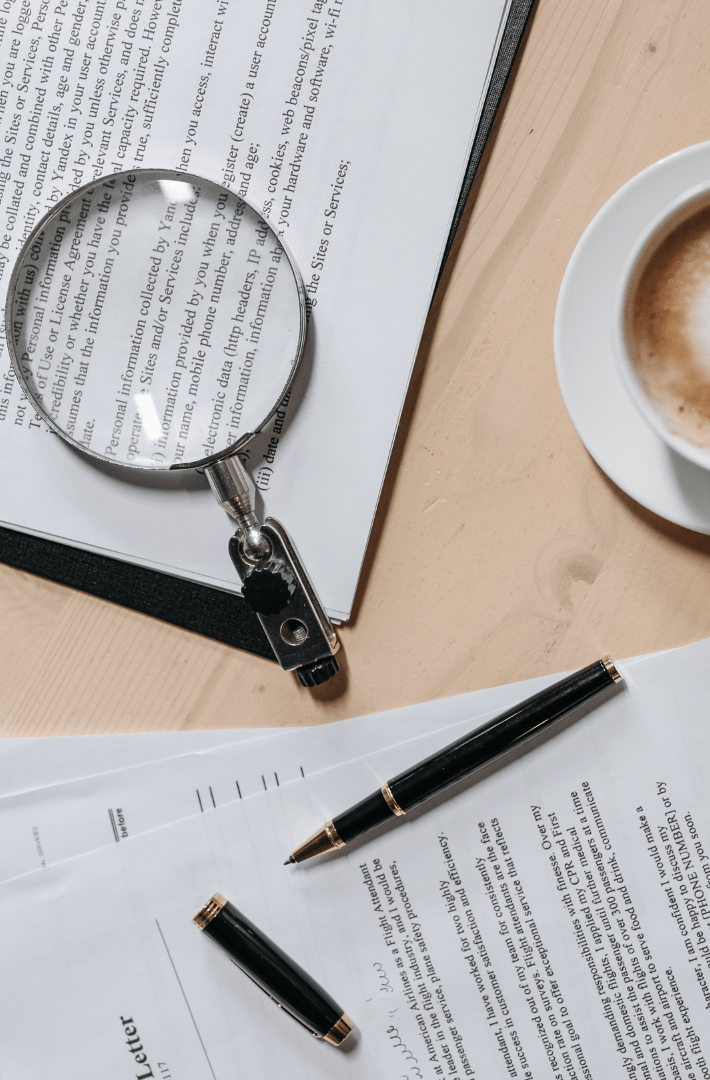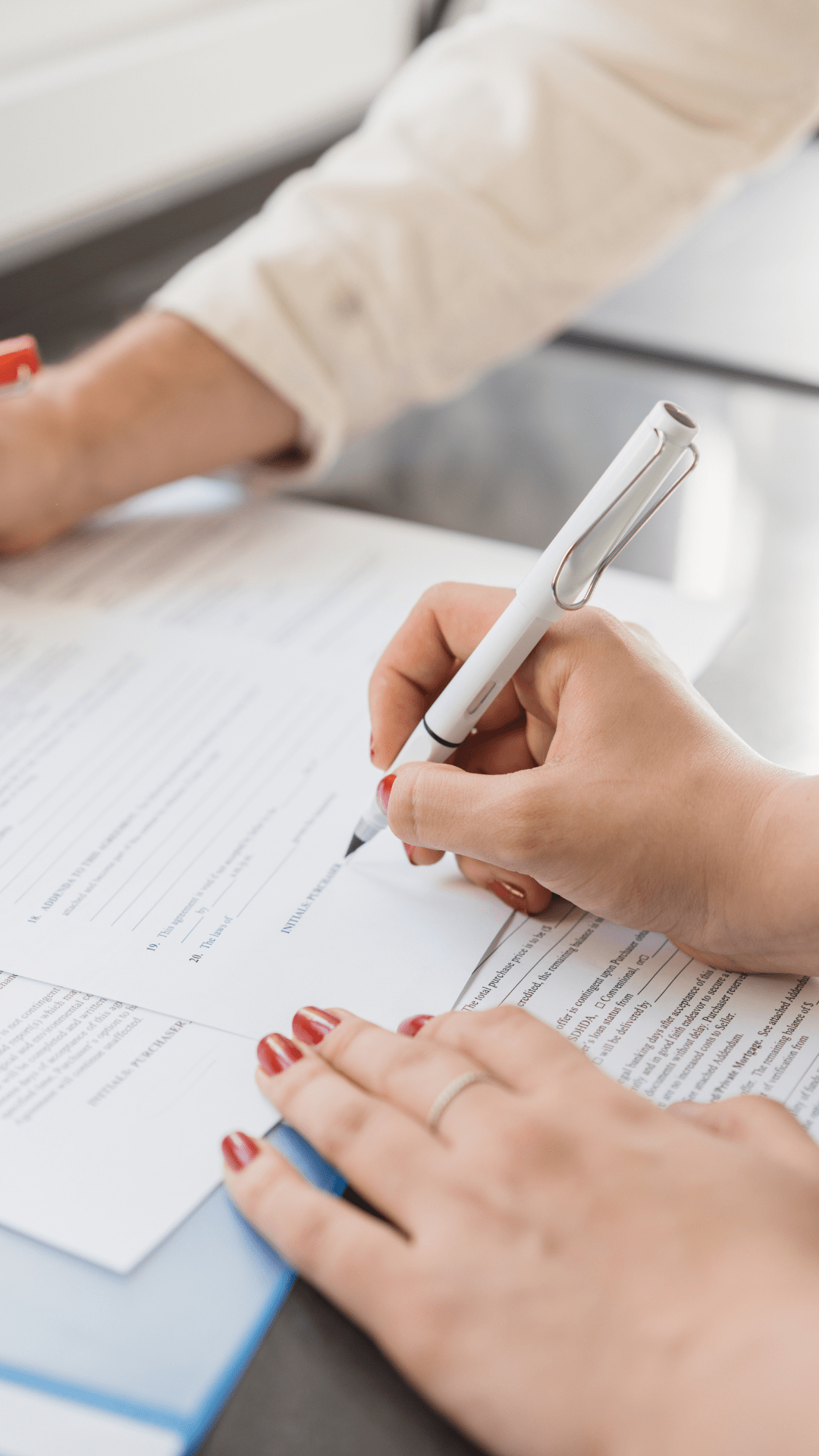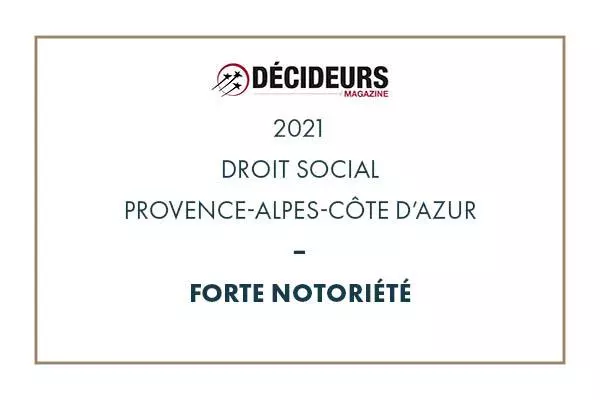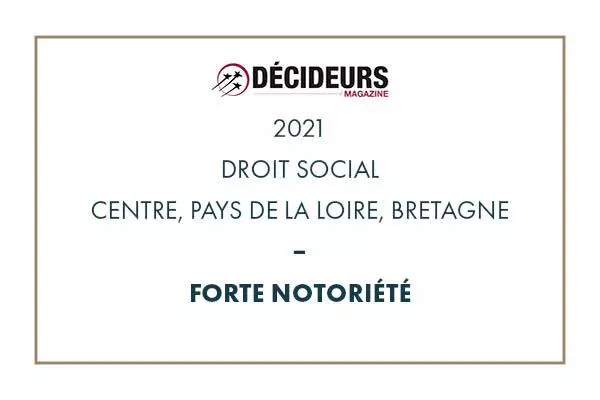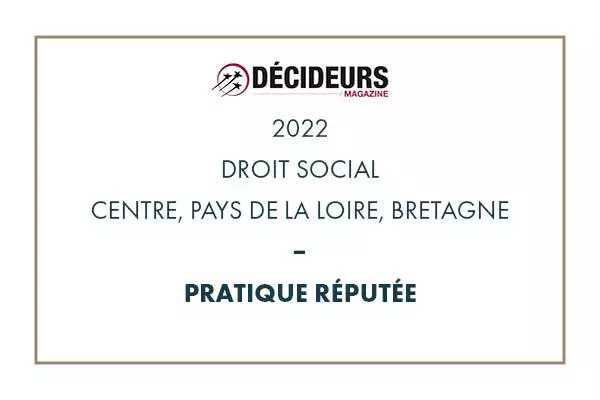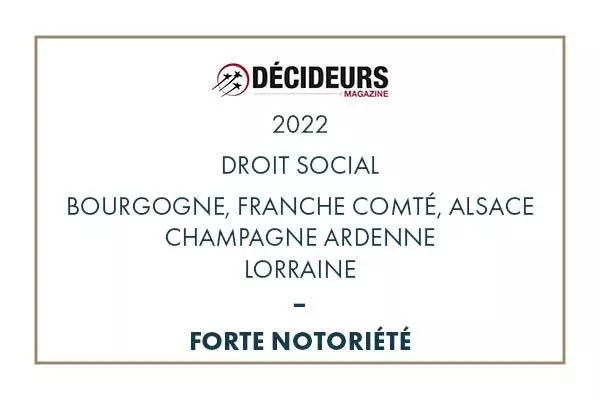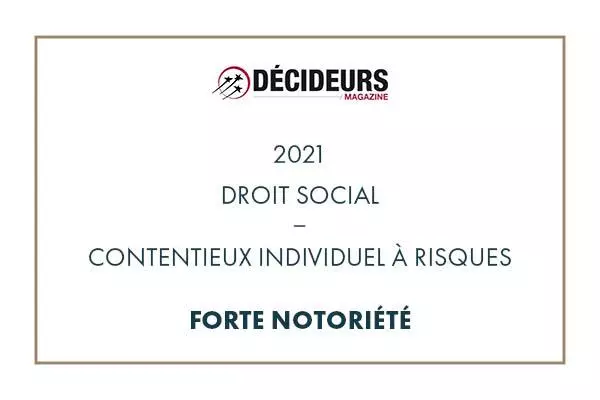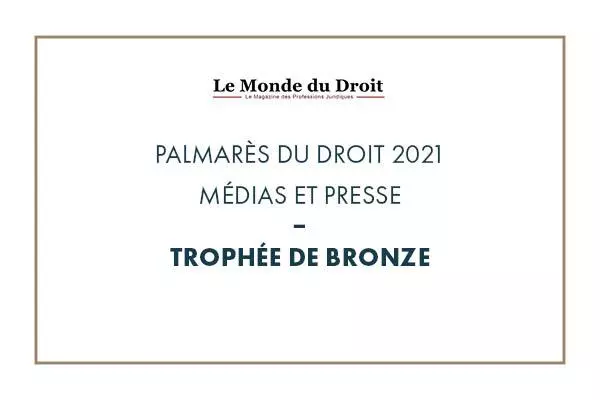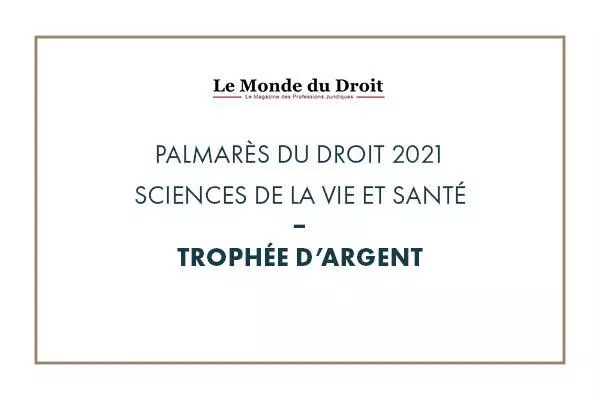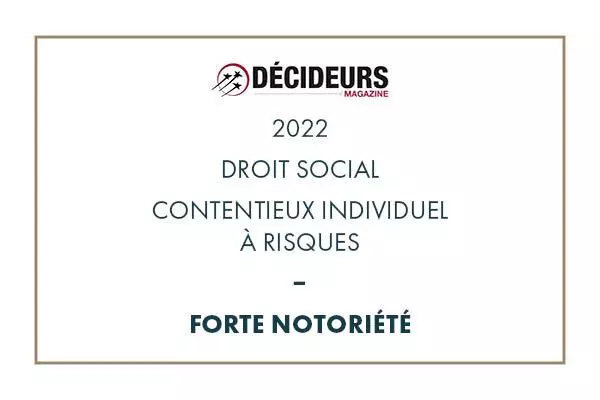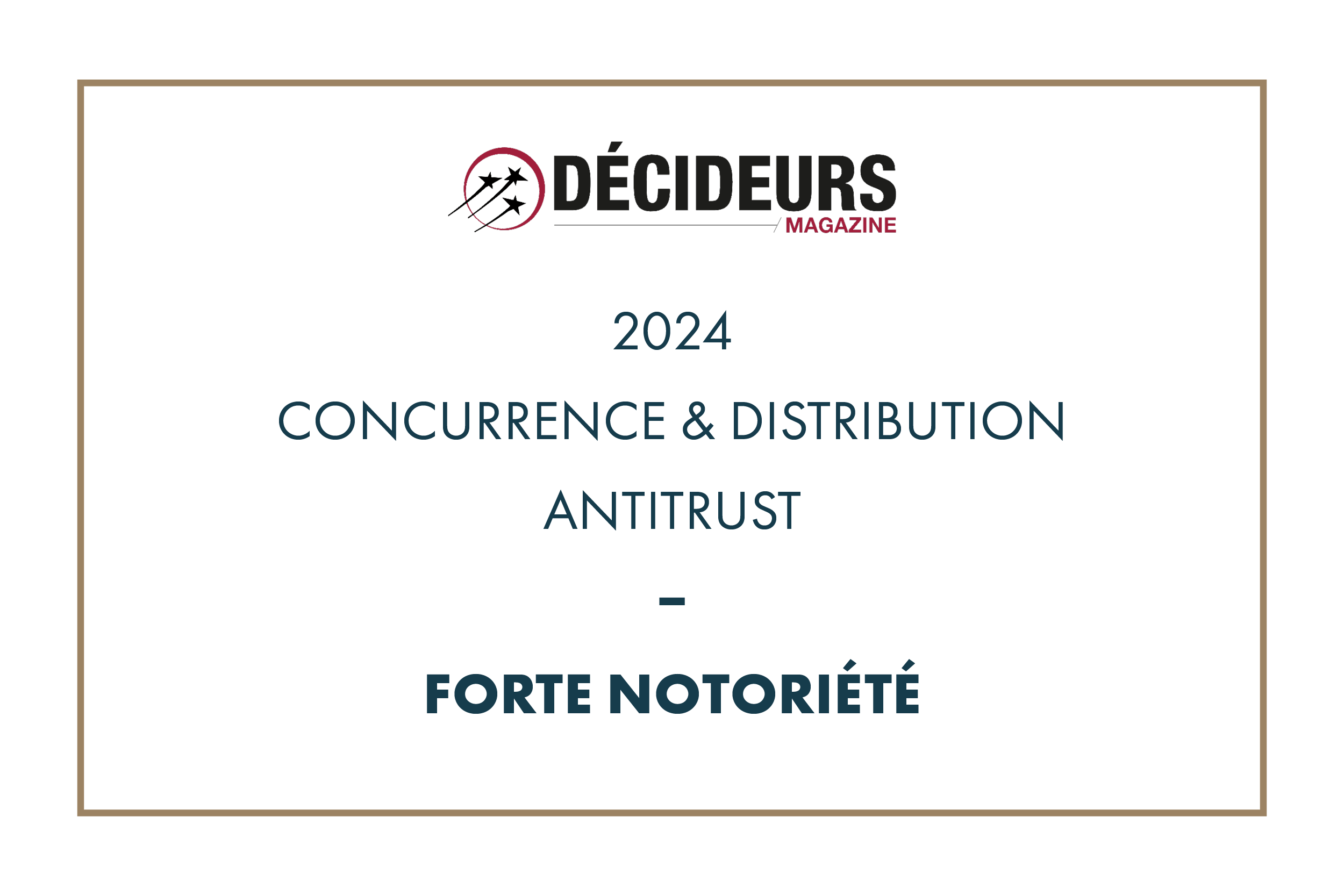Rupture brutale des relations commerciales établies : Le respect d’une clause contractuelle de résiliation ne fait pas échec à son application
29 avril 2025
Depuis la loi Galland de 1996, l’article L.442-1, II du Code de commerce sanctionne le fait pour « une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale ».
La rupture brutale des relations commerciales établies est en effet une pratique restrictive de concurrence, dont l’objectif affiché par le législateur était de lutter contre le déréférencement abusif des fournisseurs, en particulier dans le secteur de la grande distribution.
Ce qui est reproché à l’auteur de la rupture des relations commerciales, ce n’est pas la rupture en elle-même, mais la brutalité avec laquelle elle est mise en œuvre[1], c’est-à-dire lorsque le préavis est insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale, voire lorsque la rupture n’est assortie d’aucun préavis. Par ailleurs, même si les parties conviennent contractuellement d’un délai de préavis, le juge peut en écarter l’application s’il estime qu’il est insuffisant[2]. Le législateur a toutefois prévu quelques garde-fous : la responsabilité de l’auteur de la rupture ne pourra en aucun cas être engagée « du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de 18 mois »[3].
La jurisprudence est certes déjà très fournie sur ce sujet mais elle ne cesse toutefois d’en préciser les contours.
rupture brutale et clause de résiliation anticipée insérée dans un contrat
Le 19 mars 2025, la Cour de cassation a estimé qu’un préavis d’une durée de 4 mois est insuffisant au regard d’une relation commerciale établie depuis 28 ans et constitue alors une rupture brutale des relations commerciales au sens de l’article L.442-1, II du Code de commerce, et ce, même si les parties avaient inséré dans leur contrat une clause de résiliation anticipée[4].
En l’espèce, la société Chevignon, dont l’activité principale est la vente d’accessoires sous les marques « Charles Chevignon » et « Chevignon » a concédé à une société une licence exclusive pour fabriquer et vendre des lunettes sous ces marques. Un premier contrat a été conclu en 1991 pour une durée de 7 ans. Les relations commerciales se sont ensuite poursuivies en exécution de contrats de licences successifs et la dernière convention a été conclue pour une période de 3 ans, de 2019 à 2021. Toutefois, les parties avaient prévu la possibilité de résilier le contrat de manière anticipée et sans pénalité.
Par une lettre du 28 août 2019, la société Chevignon a notifié à son cocontractant la rupture du contrat de licence à compter du 31 décembre 2019 (soit un préavis de 4 mois). Ce dernier a assigné la société Chevignon en lui reprochant l’insuffisance du préavis accordé et la société a été condamnée à payer plus de 230.000 euros au titre de la perte de marge brute subie en raison de la rupture brutale des relations commerciales établies.
Devant la Cour de cassation, la société Chevignon conteste la qualification de relation commerciale établie, estimant que la relation entre les parties, constituée d’une série de contrats à durée déterminée, sans clause de prorogation tacite et offrant aux parties la faculté de résilier de manière anticipée le contrat, s’analysait comme étant une relation précaire, d’autant plus que chaque contrat prévoyait en cas de renouvellement, la renégociation de ses éléments essentiels.
Toutefois, la Cour de cassation rejette les prétentions de la société Chevignon. Elle confirme l’analyse de la cour d’appel de Paris qui avait souligné que même si les parties devaient renégocier à chaque échéance les termes des contrats, ceux-ci étaient reconduits de manière systématique à des conditions globalement identiques et sans mise en concurrence, et ce, pendant 28 ans, ce qui n’est pas de nature à rendre la relation précaire.
La cour d’appel avait ajouté que « le fait que la rupture en cours d’exécution soit possible en droit n’implique pas qu’elle soit prévisible en fait ». Ainsi, la continuité et la stabilité de la relation permettait aux parties de croire raisonnablement que la faculté de résiliation anticipée ne serait pas utilisée.
La Cour de cassation valide ainsi le raisonnement de la cour d’appel selon lequel les conditions de la rupture n’ont pas garanti à la société victime la possibilité de bénéficier d’un préavis effectif. La société n’ayant pu se réorganiser dans le délai imparti, la rupture brutale de la relation commerciale est avérée.
précisions sur la date de début du préavis
Par ailleurs, quelques jours plus tôt, dans une autre affaire, la Cour de cassation avait précisé que « l’écrit par lequel une entreprise notifie son intention de ne pas poursuivre une relation commerciale établie ne fait courir le préavis dû à l’entreprise qui subit la rupture que s’il précise à quelle date la relation prendra fin »[5]. Ainsi, bien que l’entreprise ayant subi la rupture des relations commerciales ait reçu le 30 mars 2016, un courriel l’informant de la volonté de son partenaire de procéder à une mise en concurrence via un appel d’offres – rendant dès lors la relation commerciale précaire –, le délai de préavis n’a commencé à courir qu’à compter de la réception, en janvier 2017, d’un courrier lui annonçant que la relation prendrait fin le 1er décembre 2017.
la nature de l’action débattue devant la cjue
Enfin, il est à noter que le 2 avril dernier, la Cour de cassation a renvoyé à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) la question de savoir si l’action indemnitaire pour rupture brutale des relations commerciales établies relève de la matière contractuelle ou délictuelle[6], la compétence du juge variant selon ces deux qualifications.
Quelques jours plus tôt, la Cour de cassation avait qualifié cette action de délictuelle, donnant ainsi compétence au juge du lieu du siège social de la victime (France) plutôt qu’au lieu de l’exécution du contrat (Etats-Unis). Cette position est contraire à celle de la CJUE, qui retenait jusqu’ici que l’action relève de la matière contractuelle. La réponse de la CJUE est donc vivement attendue pour assurer prévisibilité et sécurité juridique aux justiciables.
[1] Com, 6 mars 2007, n°05-18.121
[2] Cass. com., 20 mai 2014, n°13-16.398
[3] Article L.442-1, II alinéa 2 du Code de commerce
[4] Cass com 19 mars 2025, n° 23-22.182, B.
[5] Cass com, 26 février 2025, n°23-50.012
[6] Civ 1ère, 2 avril 2025, n°23-11.456


















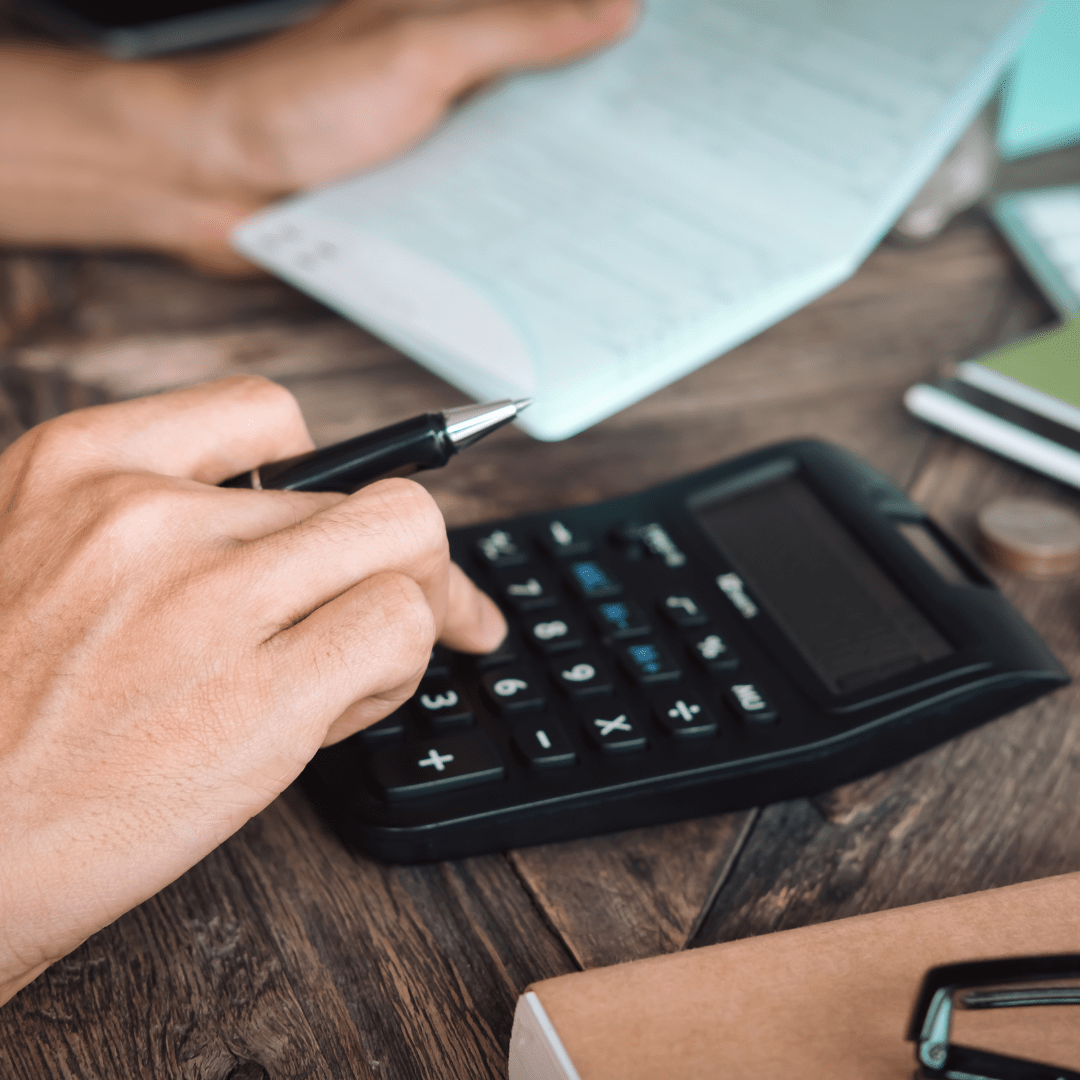





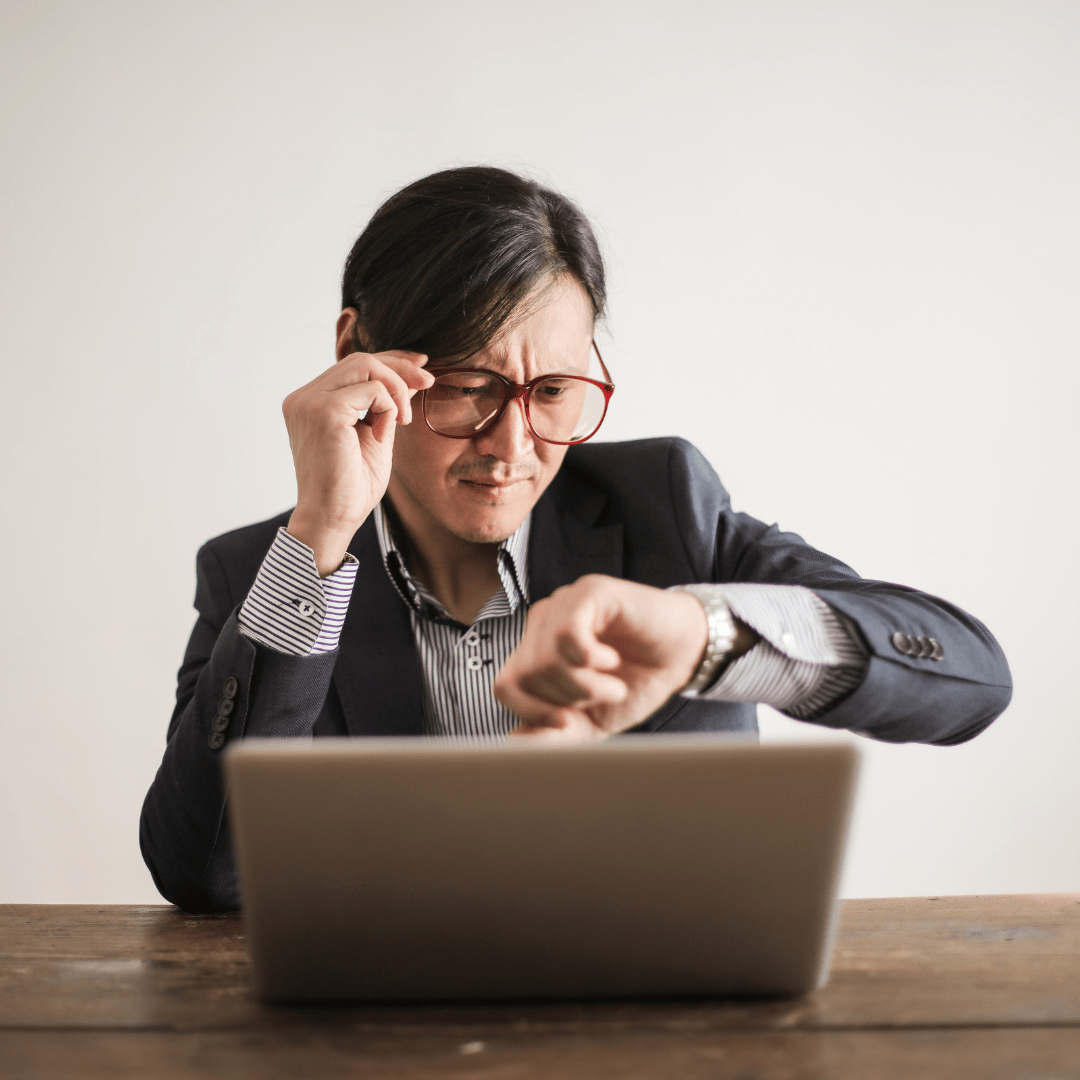

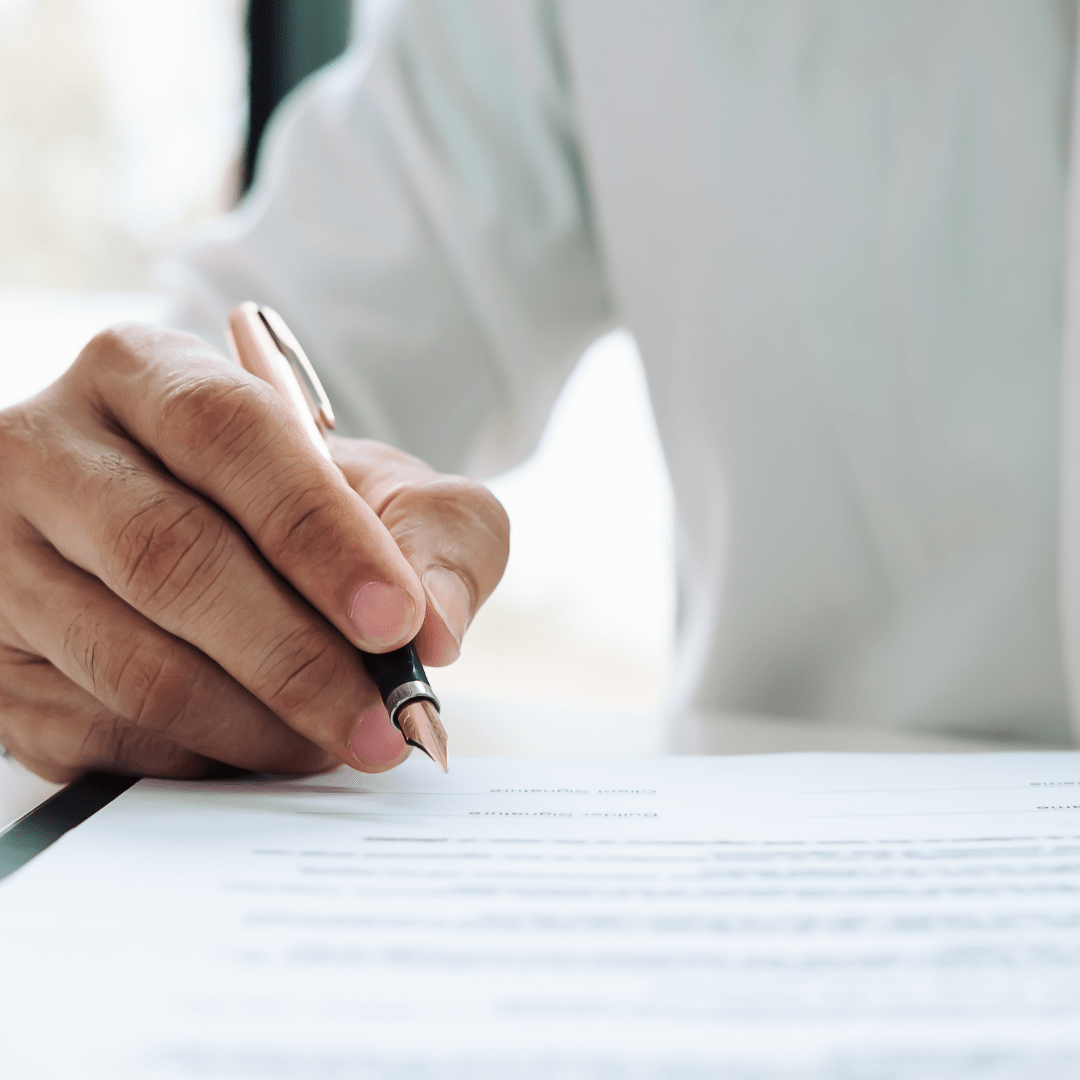
![EGALIM 3 : Une obligation de négocier de bonne foi [...]](https://www.nmcg.fr/wp-content/uploads/2024/03/Photo-article-21.png)