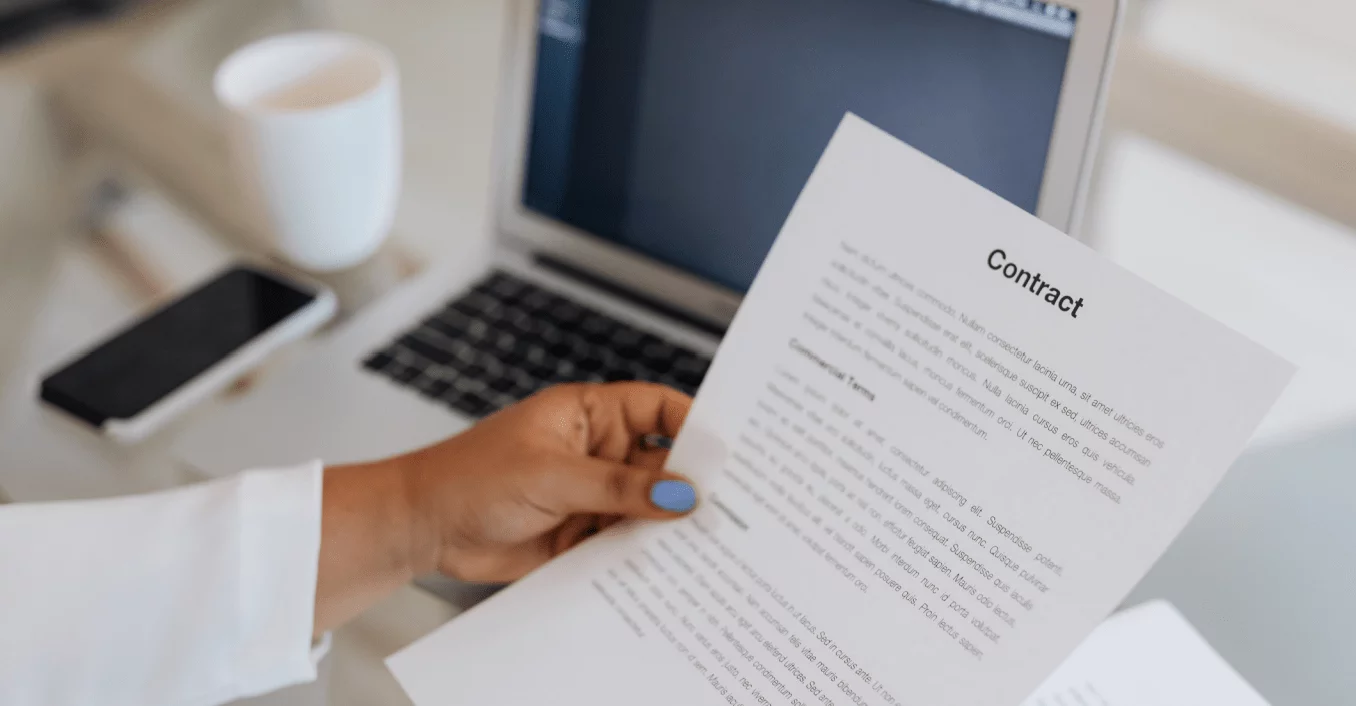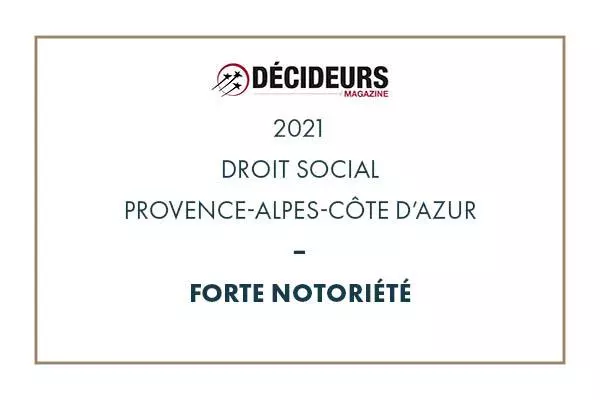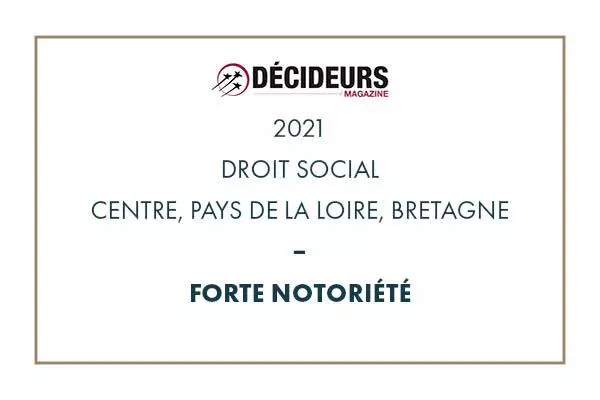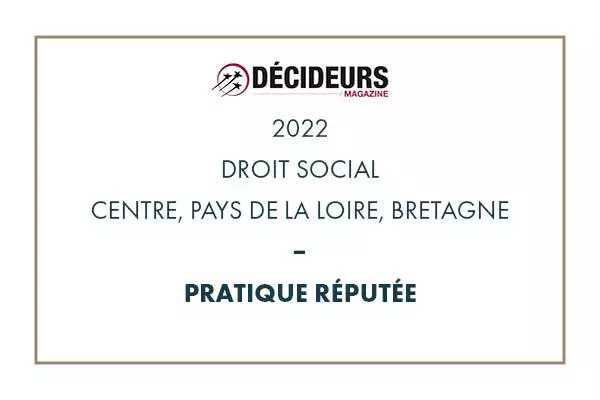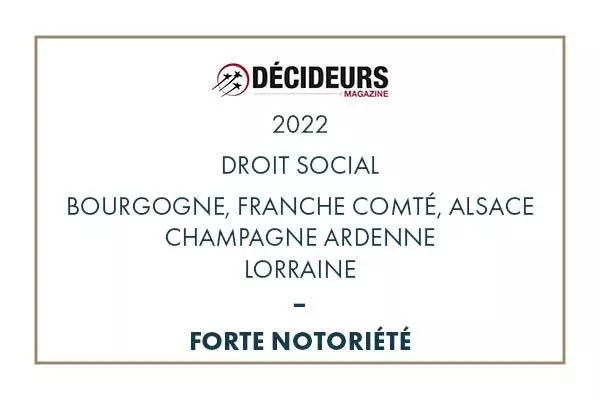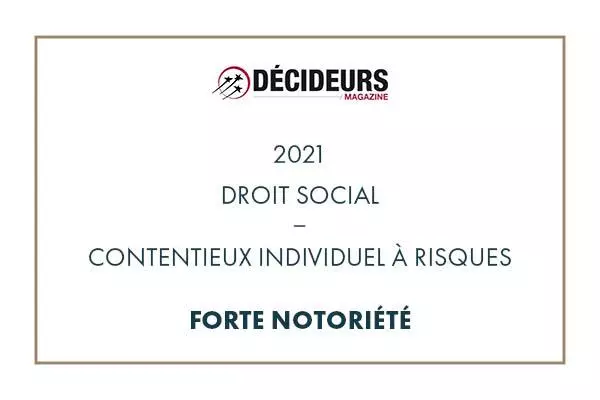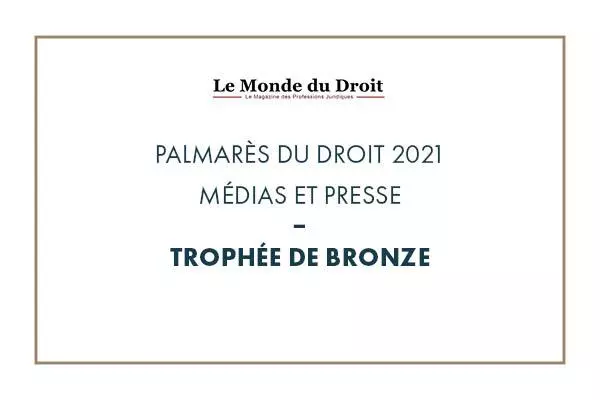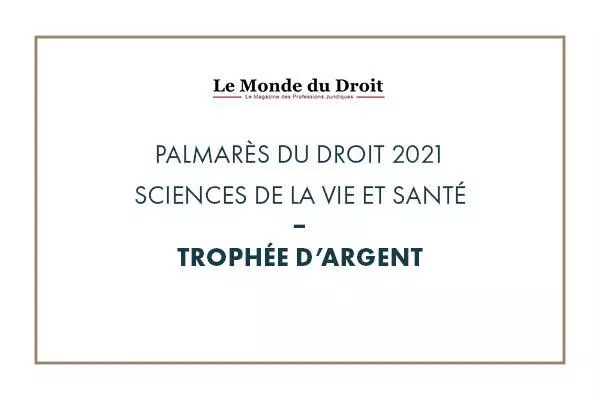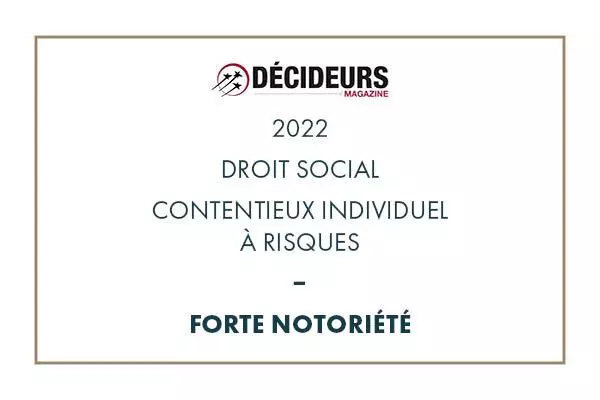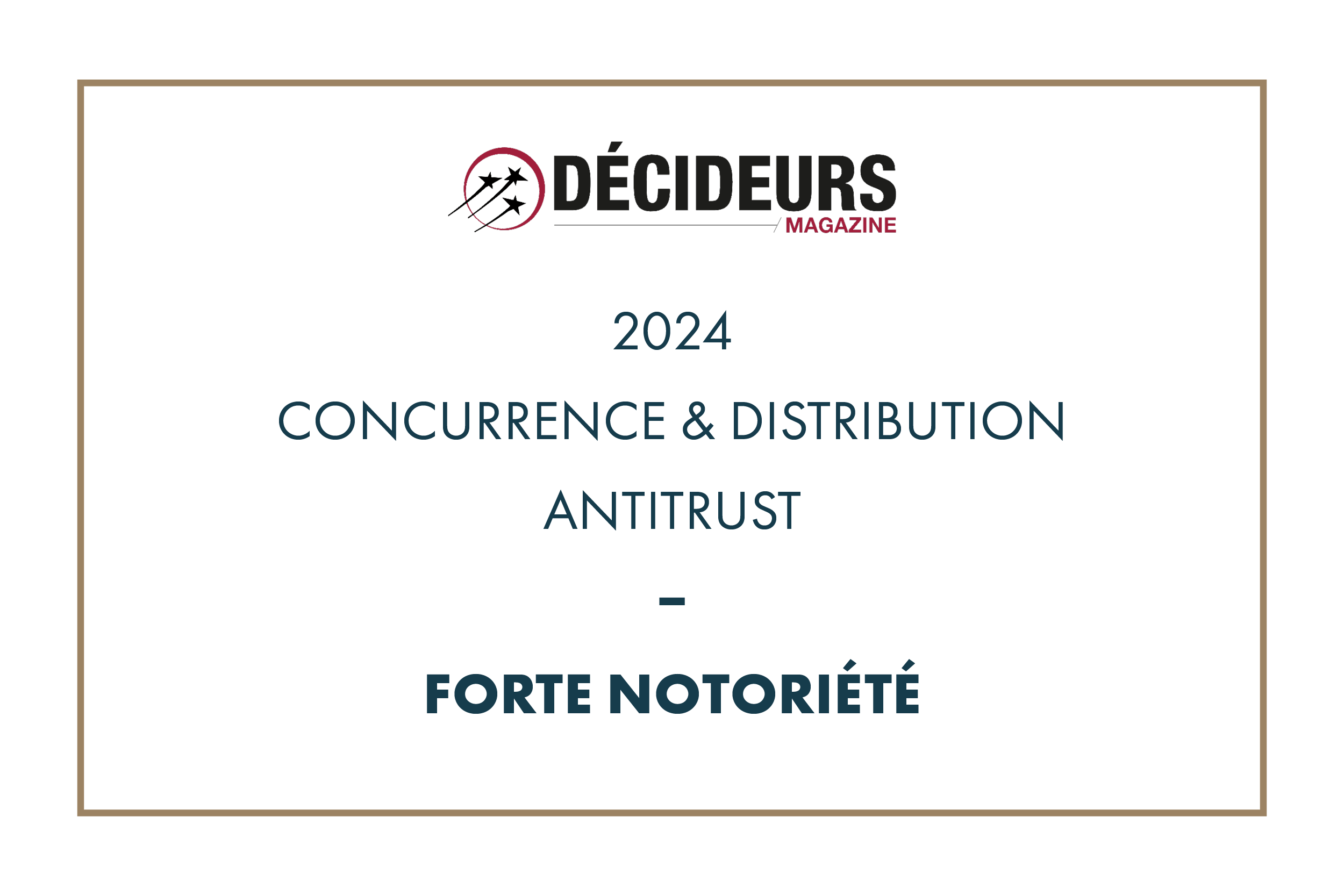La liberté de la preuve en droit pénal : de grands bénéfices nécessitant une certaine vigilance
29 avril 2025
En droit pénal, la preuve est libre.
Ce principe repose sur l’idée que le ministère public, qui défend la société, doit avoir accès aux preuves, à toutes les preuves, peu importe la manière dont elles ont été recueillies. Le parquet dispose ainsi, dans la limite du respect des droits et libertés fondamentaux, de diverses prérogatives pour rechercher des preuves.
Lorsque le parquet n’a pas connaissance d’une infraction et n’a donc pas mis en œuvre l’action publique, il est possible de l’en informer à travers un outil juridique connu de tous : la plainte. Toutefois, compte tenu de l’encombrement des tribunaux (le taux de procureurs rapporté à la population est en France l’un des plus faible d’Europe (cf rapports CEPEJ[1]), nombreuses sont les plaintes qui ne suscitent pas l’intérêt des parquets.
Les enquêtes, et les perquisitions qui vont avec, pour rechercher les preuves des infractions dénoncées, ne sont jamais mises en œuvre. La conséquence est simple, sans preuves, les délits commis contre les entreprises ne peuvent pas être poursuivis. Il est plus que recommandé d’être pro-actif dans la construction de son dossier pénal.
En cas de soupçons de la commission d’infractions pénales et face au risque de déperdition d’éléments, la conservation des preuves est un impératif, et parfois même une course contre la montre.
Si l’auteur des infractions apprend le dépôt d’une plainte pénale contre lui, il s’empressera de détruire les preuves en sa possession, de plus en plus sur des supports informatiques. La victime de l’infraction est seule pour cette récolte de preuve
Une voie de droit existe pour l’aider dans cette conservation : le référé probatoire (aussi dénommé mesure d’instruction « in futurum ») fondé sur l’article 145 du Code de procédure civile (ci-après « 145 CPC »).
Cette voie de droit peut être introduite par requête auprès de la juridiction. Qui dit requête dit non contradictoire, présentant ainsi l’avantage de rester inconnue de l’adversaire, en tout cas jusqu’à sa mise en œuvre.
L’effet de surprise est entier et diminue le risque de déperditions de preuves, notamment sur support électronique. Cette procédure se rapproche beaucoup de la procédure de « pre-trial discovery », très pratiquée en droit américain préalablement aux litiges civils et commerciaux. La pratique est bien ancrée en droit commercial, son application au droit pénal est plus récente, mais parfaitement admises par les juridictions
L’action civile pour servir l’action pénale
Le référé probatoire permet de solliciter, par voie de requête, du Président du Tribunal judiciaire ou du Tribunal de Commerce, la mise en œuvre de mesures d’instruction, dans les locaux d’une société (siège social ou locaux quelconque) voire au domicile d’une personne physique.
L’autorisation délivrée par le Président du Tribunal est subordonnée à la réunion de trois types de conditions :
- La mesure doit être légalement admissible : elle ne doit pas excéder ce qui est nécessaire à la manifestation de la vérité et elle ne doit pas porter pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale.
- La mesure doit reposer sur un motif légitime : c’est à dire aussi bien la conservation (risque de déperdition de preuves trop important) que la recherche de preuves (soupçons de la commission d’une infraction sans certitude des faits commis).
- Enfin, au regard de la finalité de la requête, celle-ci doit intervenir avant tout procès : la jurisprudence retient une acception large du potentiel procès à venir qui peut être civil, administratif ou bien pénal.
Lorsqu’il fait droit à la requête, le Président du Tribunal rend une ordonnance par laquelle il confie à un Commissaire de justice une mission détaillée de conservation de preuves.
L’ordonnance, qui reprend généralement les termes de la requête, prévoit traditionnellement que l’Huissier peut s’adjoindre d’un expert informatique, un serrurier et peut solliciter le concours de la force publique, puisqu’il s’agit de l’exécution d’une décision de justice.
Ces opérations visent à d’obtenir un certain nombre de données inaccessibles sinon, et qui seront utiles pour susciter l’intérêt du parquet.
Mais une telle mesure, exorbitante du droit commun, puisqu’elle repose sur une requête non contradictoire (l’adversaire n’est pas appelé à se défendre), doit donc se projeter sur la contestation dont elle pourra faire l’objet une fois mise en œuvre.
Car après l’exécution de la mesure de sauvegarde de preuves par l’huissier, celui ou celle visé par la mesure est en droit d’en contester la légitimité en demandant la rétractation de l’ordonnance qui y a fait droit.
Il faut donc être complet et transparent lors de la requête, faute de quoi la découverte de situations passées sous silence lors de la demande conduira inévitablement à la rétractation de la décision de justice initiale.
De même, le demandeur devra être précis, dans le temps et les thématiques qui seront l’objet des recherches informatiques.
Le référé 145 ne saurait être un supermarché de la preuve.
Les requêtes, pour être reçues par les tribunaux, et ne pas être désavouées lors des recours en rétractation, doivent être faites sur mesure pour coller à la réalité du dossier. La bataille judiciaire qui suit peut en effet devenir homérique, suivant la nature des informations et documents obtenus.
Ici deux cas de figurent doivent être présentés.
Soit le tribunal dans l’ordonnance a demandé que les éléments recueillis par l’huissier soient conservés par celui-ci entre ses mains.
Il faudra alors attendre la fin des recours judiciaires pour en faire usage.
Soit, comme cela arrive parfois, le juge n’a pas prévu de séquestre entre les mains de l’huissier.
Les pièces, même en cas de requête en rétractation, doivent alors être versées sans délai au soutien de la plainte qui était en préparation, et déposées auprès du procureur.
Ces éléments resteront acquis au débat pénal.
La réciprocité appelle la prudence
La possibilité d’introduire une requête probatoire implique, a contrario, la possibilité de la subir.
Cette procédure étant non-contradictoire, aucune information préalable à l’arrivée d’un commissaire de justice au siège social de sa société ou à son domicile ne sera délivrée.
Il apparaît donc indispensable de disposer des bons réflexes.
Le premier réflexe est de contacter immédiatement son avocat qui pourra se rendre sur les lieux et accompagner le requis.
Dans l’attente de l’arrivée de son avocat, le réflexe majeur, mais pas toujours facile à respecter, est de ne pas faire de déclaration au commissaire de justice qui se présente au siège ou au domicile.
Le commissaire de justice, intervenant sur ordonnance judiciaire, a pour mission de retranscrire le déroulement des opérations dans un procès-verbal.
Des déclarations spontanées, faites sous l’influence de l’anxiété et de l’inconnu peuvent amener une personne à s’auto incriminer.
Ces déclarations sont susceptibles de figurer au procès-verbal de l’huissier et risqueraient fort d’alimenter ensuite l’enquête pénale.
Les prérogatives étendues du parquet pour collecter des preuves numériques
De son côté, le parquet bénéficie de plus larges prérogatives de collecte lorsqu’il décide de mettre en œuvre l’action publique.
La plus connue est l’ouverture d’une enquête de police, dans le cadre de laquelle des perquisitions et saisies sont possibles, parfois sans même l’accord préalable d’un juge, à la différence de la requête évoquée plus haut.
La preuve joue aujourd’hui une preuve centrale dans la procédure pénale, qu’elle soit biologique (empreintes, ADN) mais surtout numérique, puisque la quasi-totalité des échanges se font désormais de cette manière.
La preuve numérique est particulièrement recherchée par les autorités publiques puisqu’il s’agit bien souvent des seules preuves existantes dans des dossiers, par exemple, de délinquance financière.
C’est ce qu’a mis en lumière le Parquet National Financier dans sa synthèse annuelle de 2024.
Le Parquet National Financier, est un parquet spécialisé à l’échelle nationale dans la grande délinquance économique et financière.
Il consacre dans son rapport annuel une page entière à la question du recueil de la preuve numérique dans le cadre des enquêtes pénales.
Ce rapport souligne les voies de droit utilisées par les procureurs pour garantir le recueil de la preuve numérique, qu’il s’agisse de données libres d’accès, de données obtenues par perquisition ou bien encore par réquisition auprès de tiers.
La masse de données collectées est souvent telles que les enquêteurs ont recours à des logiciels d’indexation pour filtrer les données.
Le logiciel d’indexation doit exclure les documents couverts par le secret professionnel entre avocats et clients (privilège des droits de la défense). Ces données protégées ne pourront pas faire l’objet d’une exploitation.
Le fait pour le PNF de revenir sur le sujet n’est pas anodin : la directive et le règlement européens dits « e-evidence » (e-preuve) sont cités[2].
Ces deux textes européens, qui entreront en vigueur en 2026, facilitent la recherche de preuves numériques, à l’échelle européenne, par les autorités.
L’une des mesures phares est l’obligation pour les fournisseurs de service, sur simple injonction d’une autorité d’un Etat membre, de produire ou conserver des preuves électroniques pour alimenter une enquête en cours ou à venir.
L’usage fait de ce nouveau paquet législatif devra être observé avec une grande attention puisqu’il facilite la recherche probatoire pour les parquets.
La question de leur usage en France se pose, tant les infractions économiques sont le parent pauvre de parquets sous dimensionnés et obligés de se concentrer sur la délinquance de droit commun, laissant parfois les entreprises seules face à elles-mêmes.
[1] Systèmes judiciaires européens, Rapport d’évaluation de la CEPEJ 2024 (Partie 2 Fiches pays) : 3,9 Procureurs pour 100 000 habitants en France en 2022, pour une moyenne de 11,2 procureurs pour 100 000 habitants en 2022 dans les Etats membres du Conseil de l’Europe (Rapport précité, p.67 : https://rm.coe.int/fiches-pays-partie-2-fr/1680b21e9a ).
[2] Règlement n°2023/1543 et Directive n°2023/1544 du 12 juillet 2023.