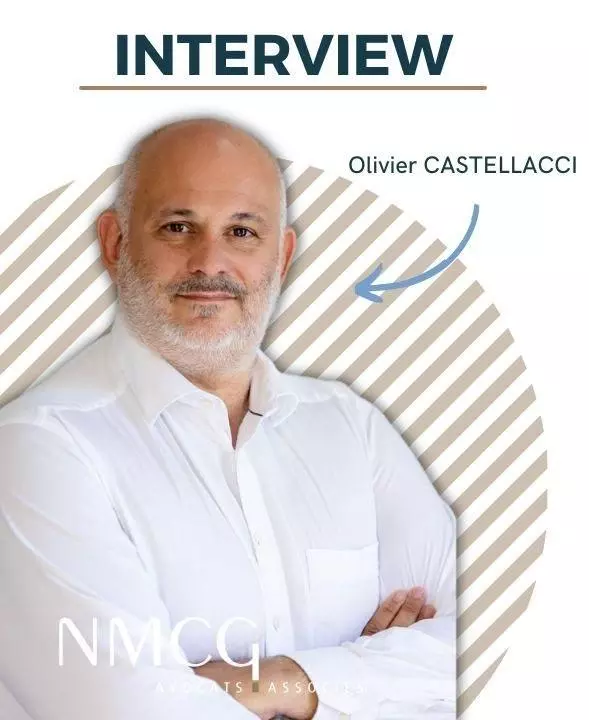meilleur atout
Un cabinet d'avocats d'affaires audacieux
pour un accompagnement à long terme
deux valeurs essentielles pour le cabinet NMCG
NMCG Avocats est un cabinet d'avocats d'affaires qui vous accompagne tant en conseil qu'en contentieux.
NMCG Avocats est doté d'un savoir-faire spécifique et de compétences variées afin de vous apporter des conseils sur-mesure répondant à vos besoins sur votre marché.
L'adhésion forte de nos clients à la qualité de notre accompagnement nous a permis de confirmer notre expertise et de nous développer, tant en nombre de bureaux sur l'ensemble du territoire que de volume d’activité, dans le respect sans faille de nos valeurs.
notre actualité
NMCG Avocats synthétise l'essentiel des informations juridiques et judiciaires pour vous faciliter la veille de votre marché et d'anticiper ses évolutions.
Plusieurs formats vous sont proposés : vidéos, articles, podcasts, formations présentielles et distancielles…
Face à une matière en constante évolution et qui connait actuellement quelques bouleversements, notre département est doté d'une équipe de spécialistes pouvant assurer la gestion de dossiers tant simples qu'extrêmement complexes. Découvrez notre accompagnement en Droit du travail et de la protection sociale
Nous vous accompagnons de la stratégie à l'exécution sur l'ensemble de vos projets structurants. Sur vos projets d'investissement ou de croissance externe, nous intervenons dès la phase de diagnostic des risques. Découvrez notre accompagnement en Corporate – Fusions & Acquisitions
Intervenant tant en phase amiable et transactionnelle que dans le cadre des procédures collectives, les membres de l’équipe Restructuring ont noué une relation de confiance avec la plupart des acteurs du marché : administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires, conseils financiers… Découvrez notre accompagnement en Restructurations
L’équipe conseille ses clients pour la mise en place de la documentation commerciale nécessaire à leurs activités. Découvrez notre accompagnement en Droit commercial – Droit des contrats
Sur tous les aspects des activités de nos clients, nos équipes apportent un support fonctionnel tant dans l'élaboration, la structuration et le déploiement des projets. Découvrez notre accompagnement en Droit de la concurrence et de la distribution
Nos équipes conseillent et défendent tous les acteurs économiques, privés et publics afin de mettre en place une politique efficace de propriété intellectuelle pour protéger et valoriser le patrimoine intellectuel des entreprises. Découvrez notre accompagnement en Droit de la propriété intellectuelle
Notre équipe dédiée aux nouvelles technologies dispose d'une connaissance solide et aguerrie des enjeux actuels et futurs afin de faire face aux évolutions du monde numérique et des outils mis à la disposition des entrepreneurs. Découvrez notre accompagnement en Droit des nouvelles technologies et économie numérique
Nos équipes de résolution de litiges s'appuient sur leurs multiples compétences représentées au sein de notre cabinet. Découvrez notre accompagnement en Arbitrage national et international
Notre équipe d’avocats conseille et représente les acteurs majeurs des secteurs de la santé, du médicament, de la cosmétique, des dispositifs médicaux et des biotechnologies. Découvrez notre accompagnement en Droit de la santé
Nos équipes accompagnent l'ensemble des acteurs de l'industrie immobilière dans le cadre de leurs opérations, délivrant des conseils efficaces et adaptés dans tous les domaines relatifs aux transactions immobilières et à la construction. Découvrez notre accompagnement en Droit immobilier
La présence d'un département pénal permet à NMCG Avocats d'intervenir au sein de chacune des disciplines du droit pénal. Découvrez notre accompagnement en Droit pénal des affaires
Notre équipe apporte son savoir-faire aux acteurs publics et privés face à un environnement réglementaire de plus en plus complexe. Découvrez notre accompagnement en Droit public – Regulatory
toute la France





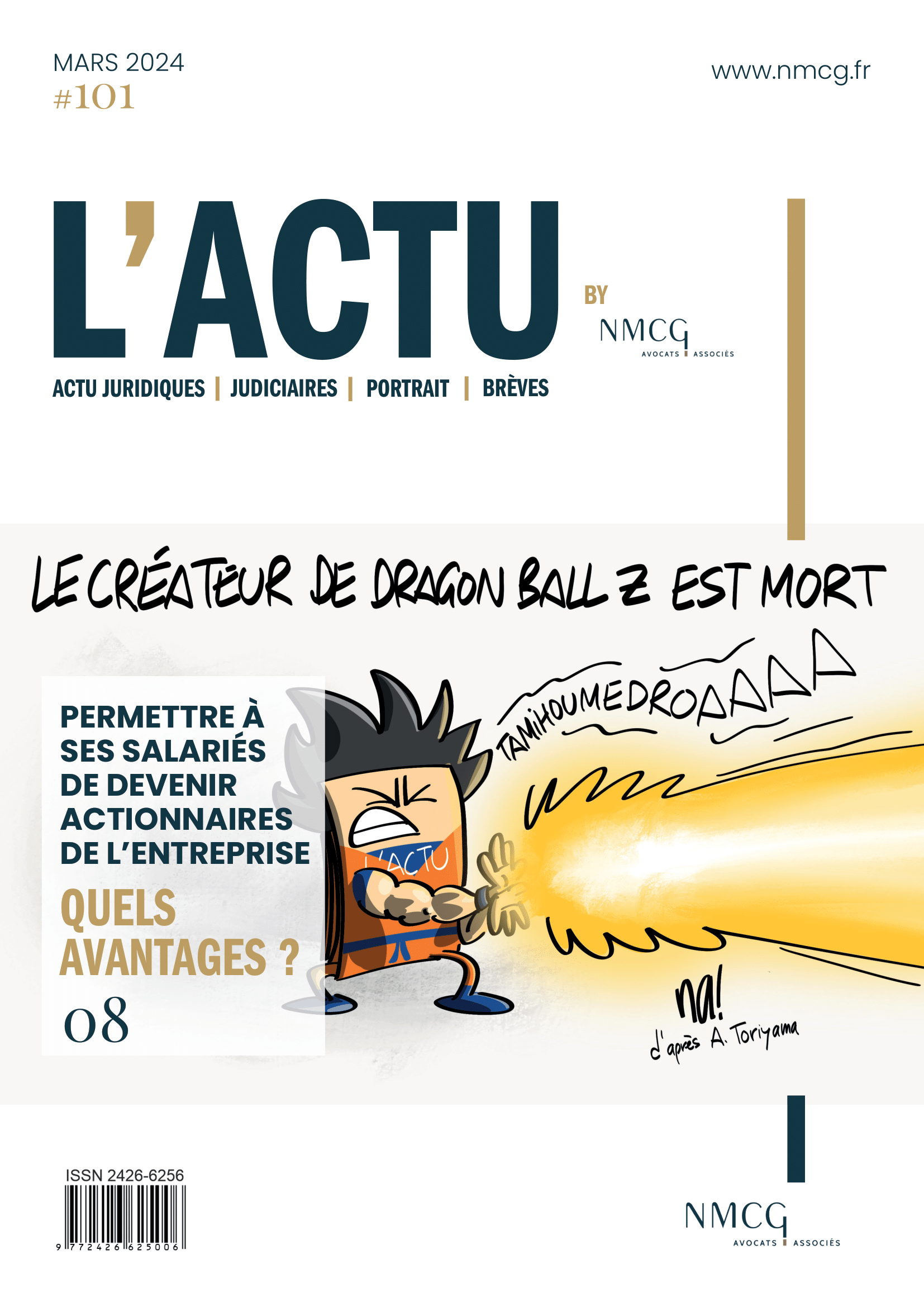




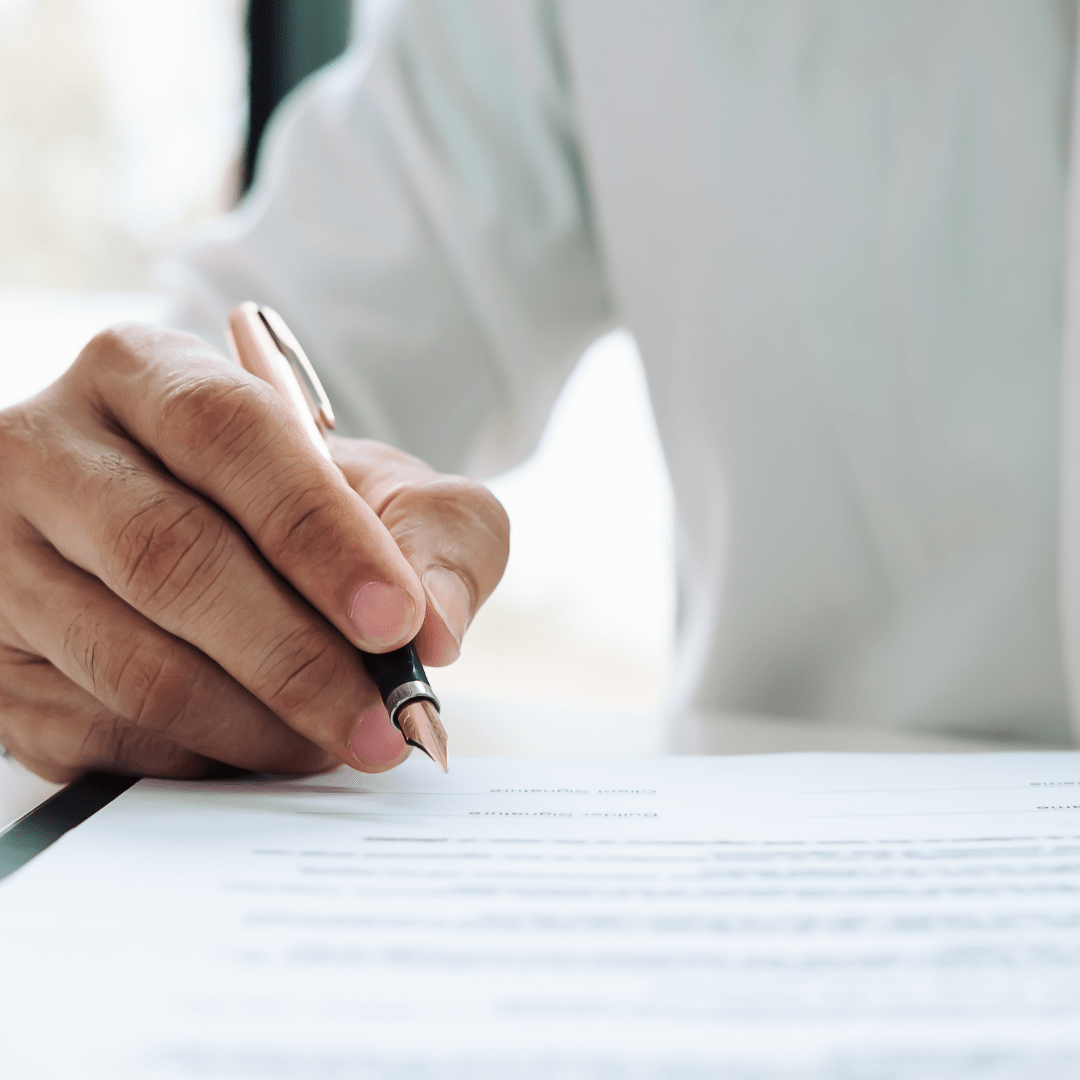


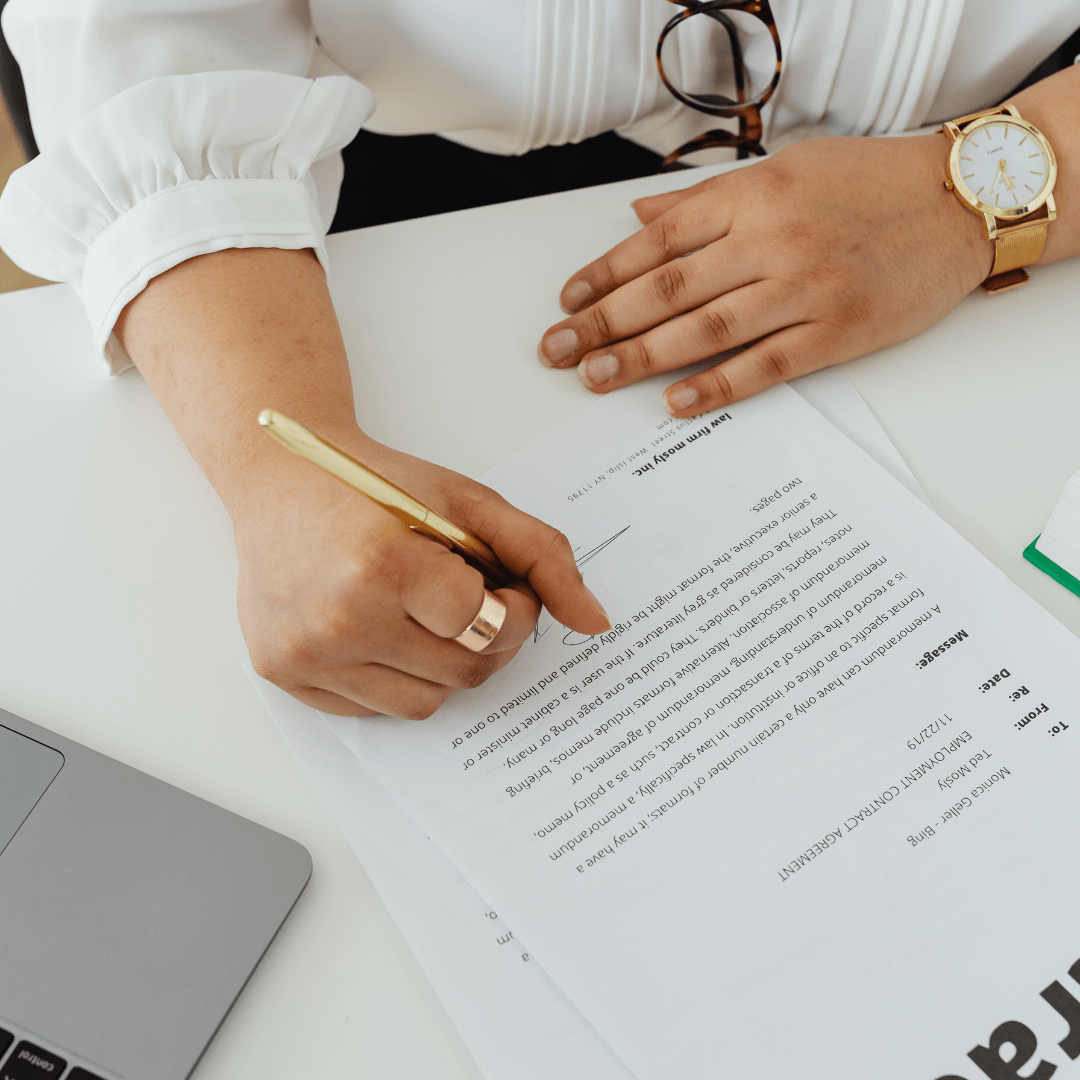
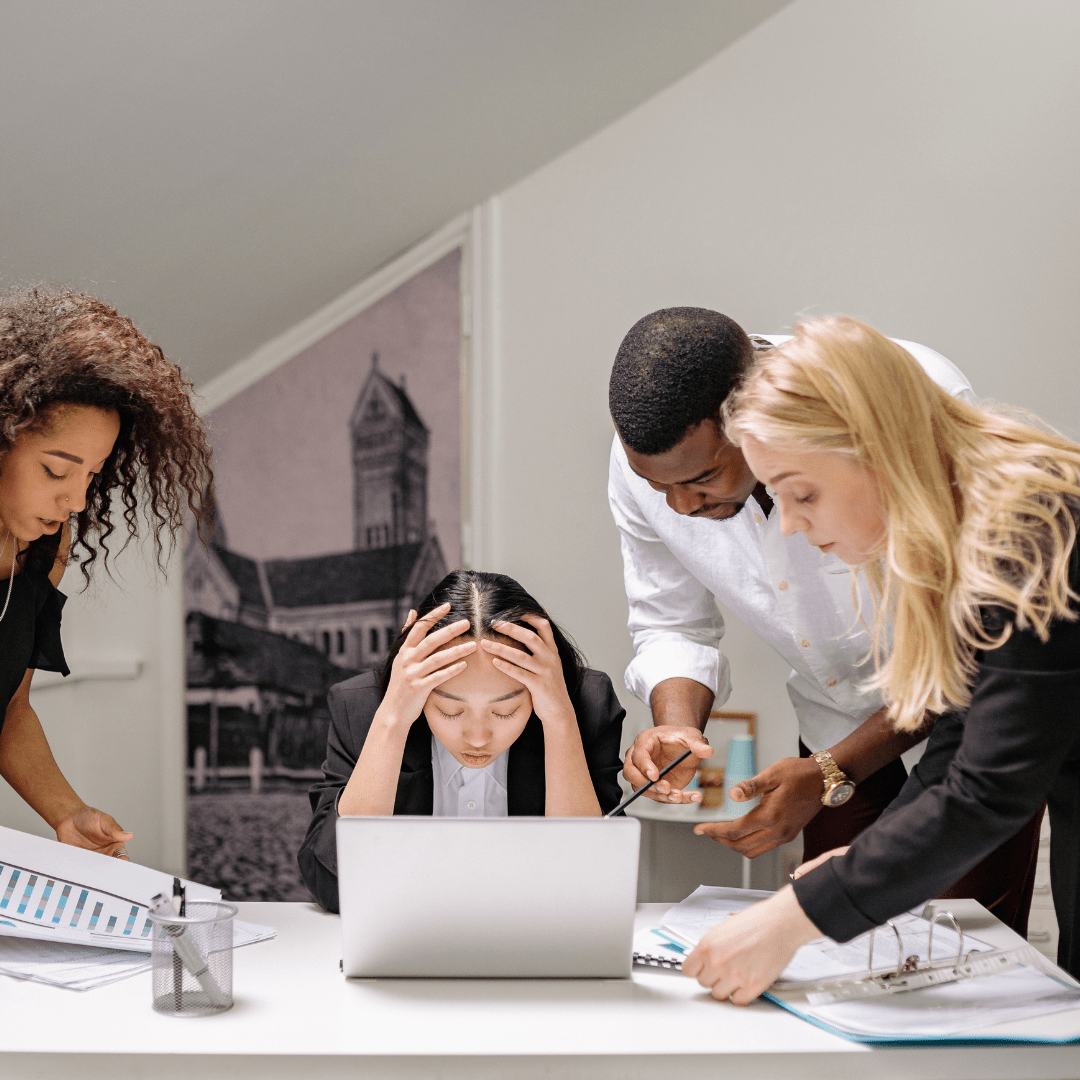
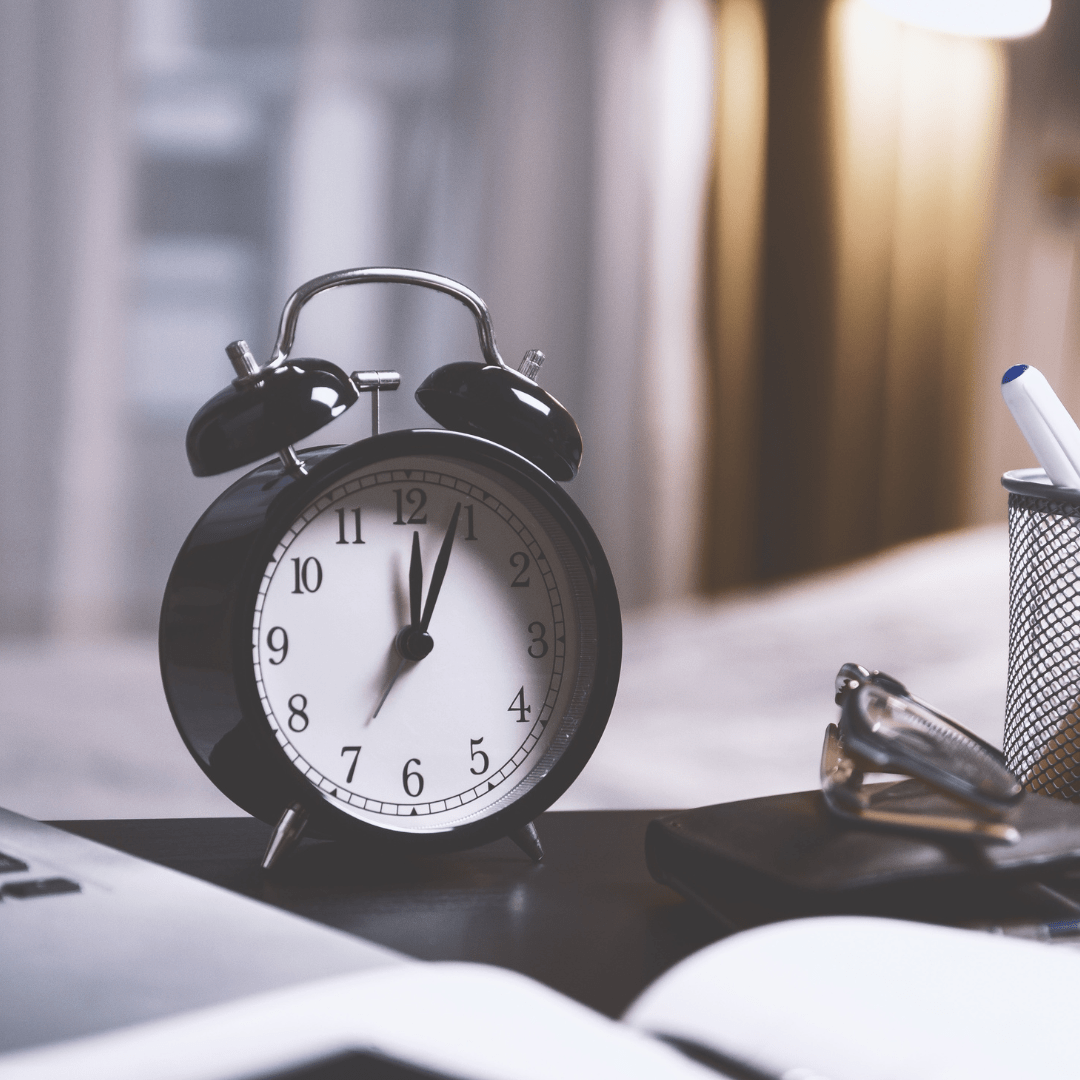












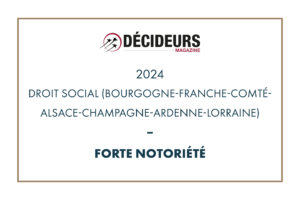
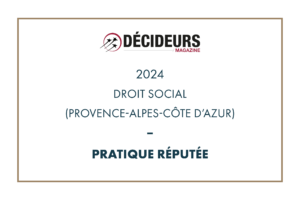
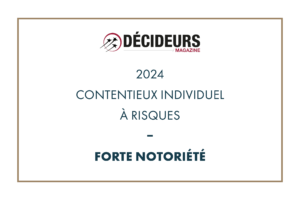












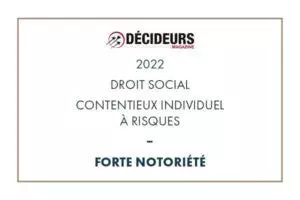


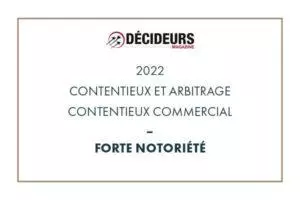





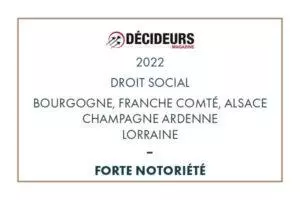


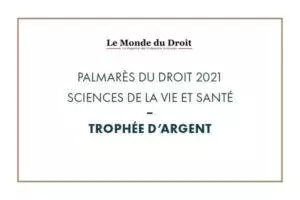
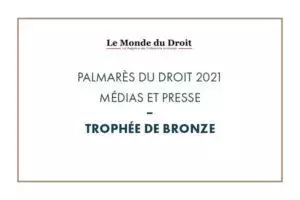


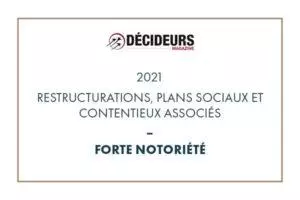
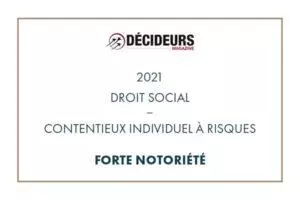
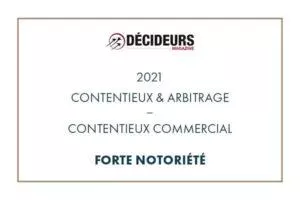

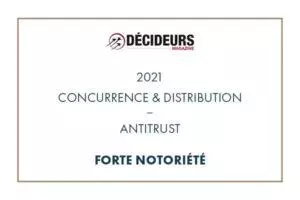
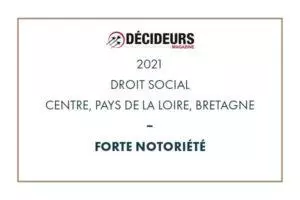

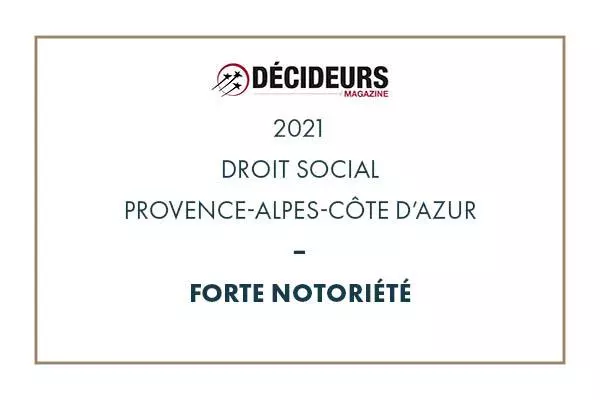

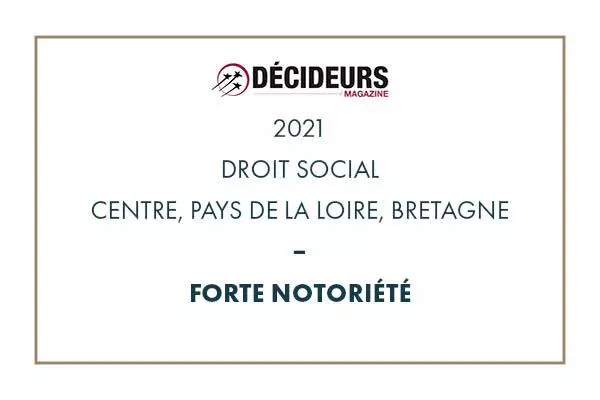
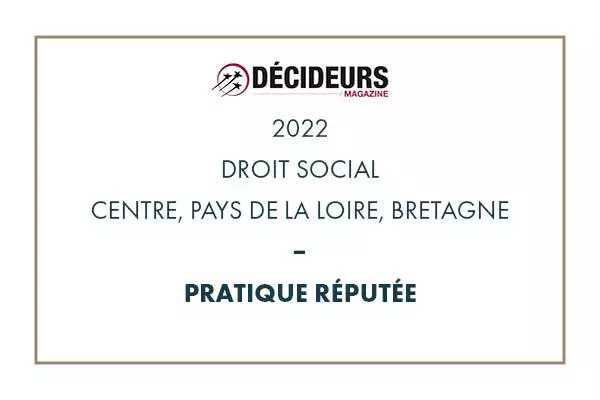
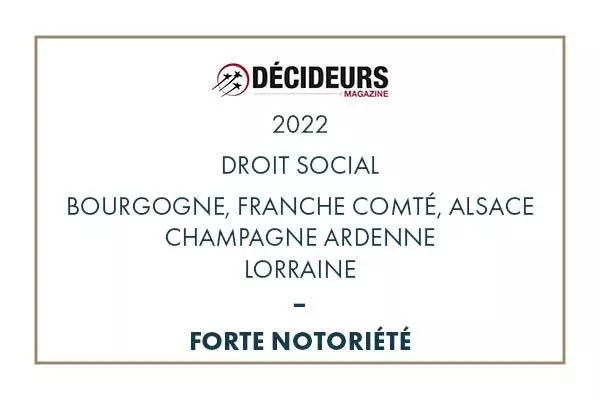



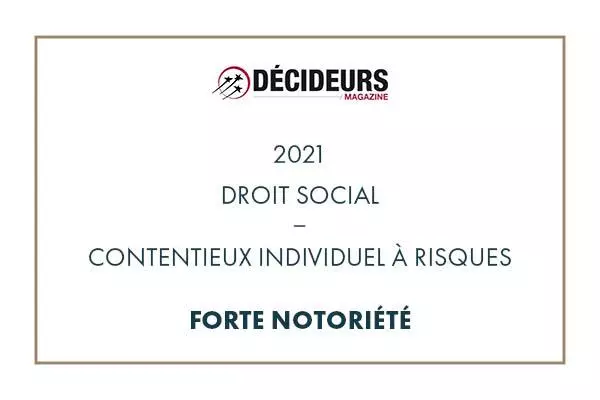







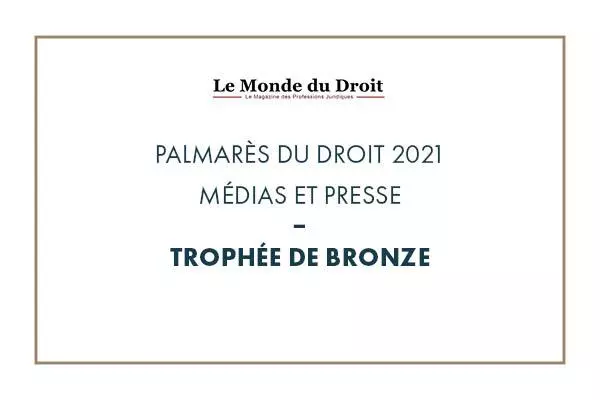
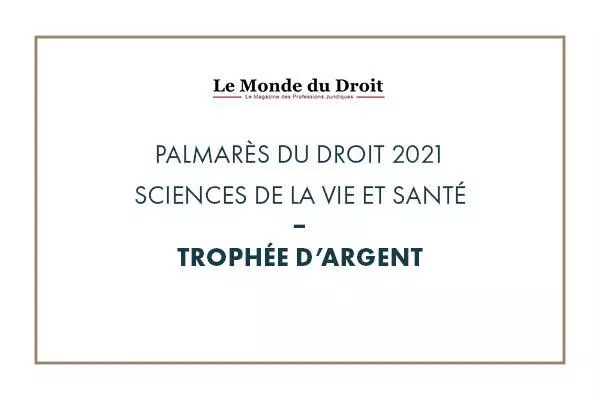




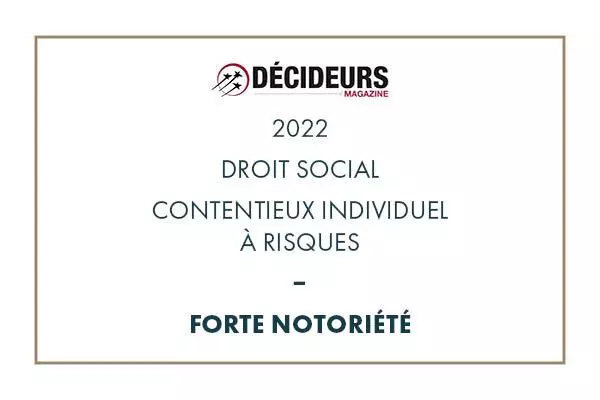

















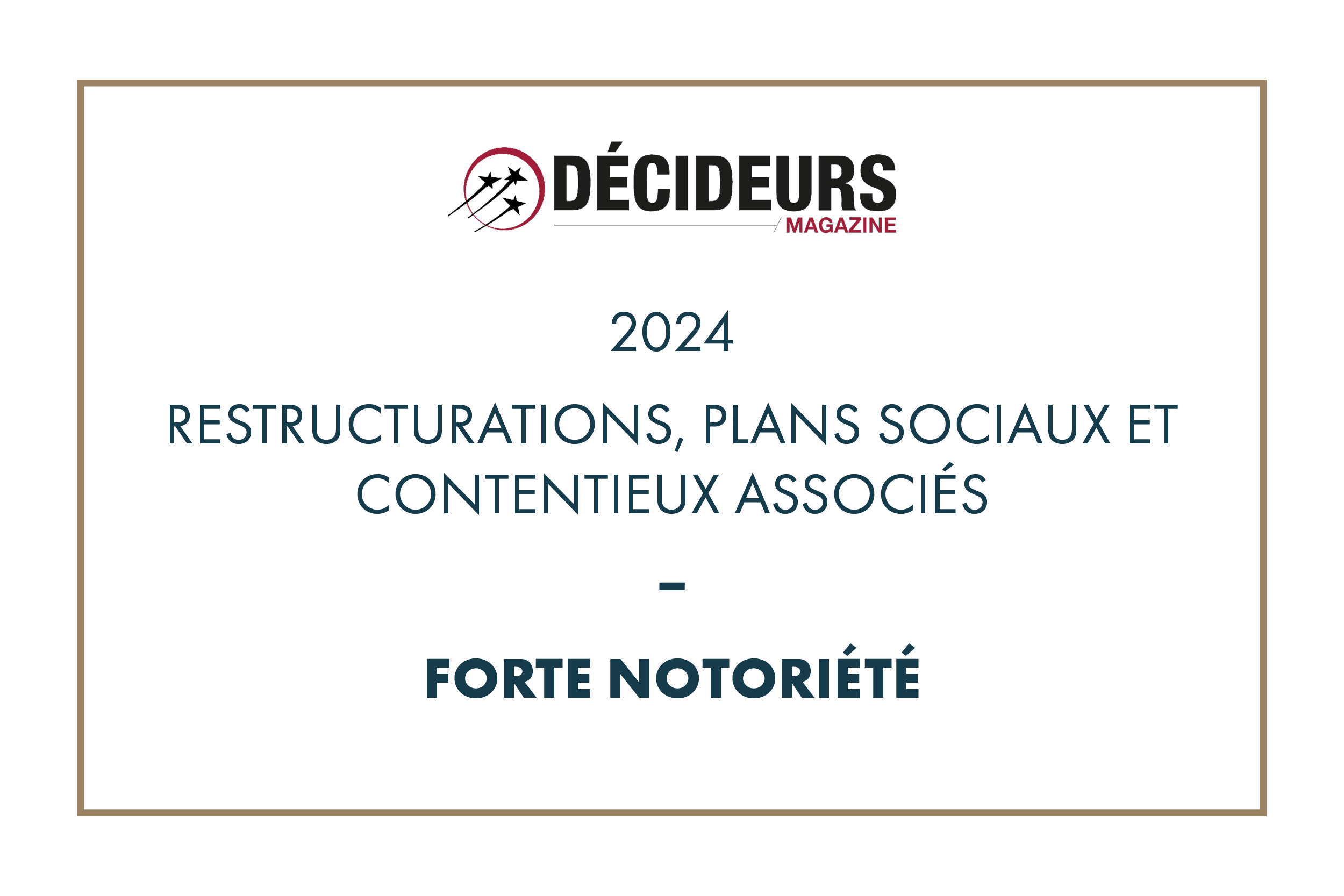




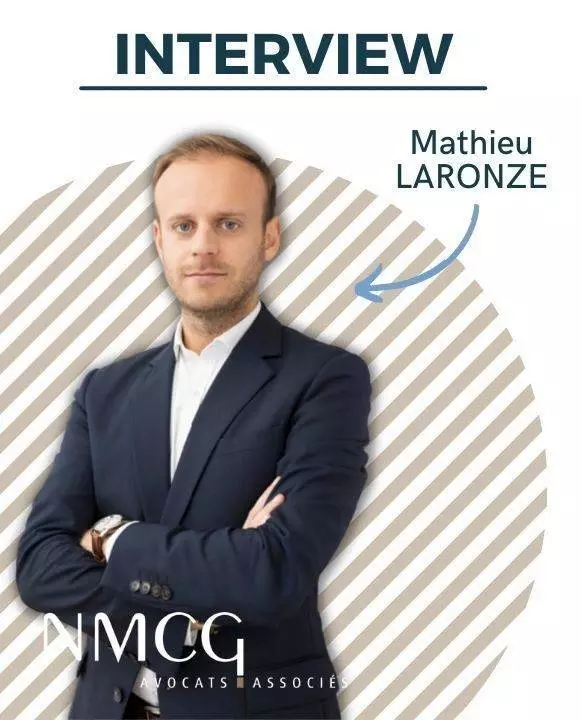
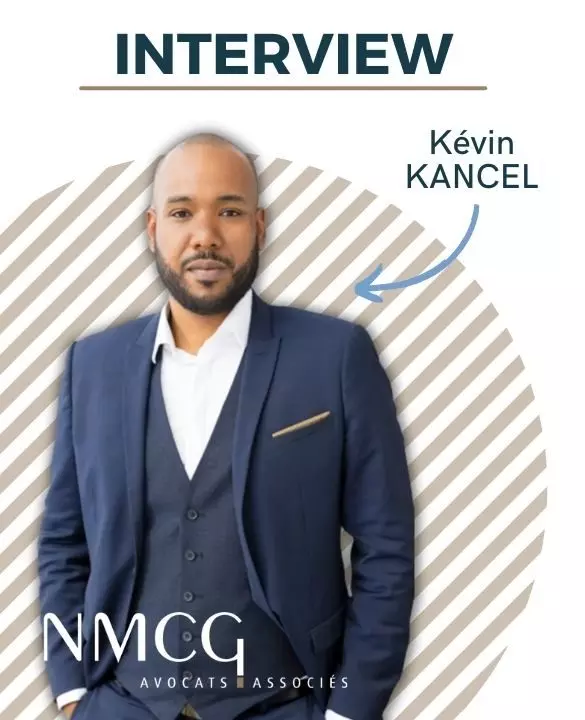


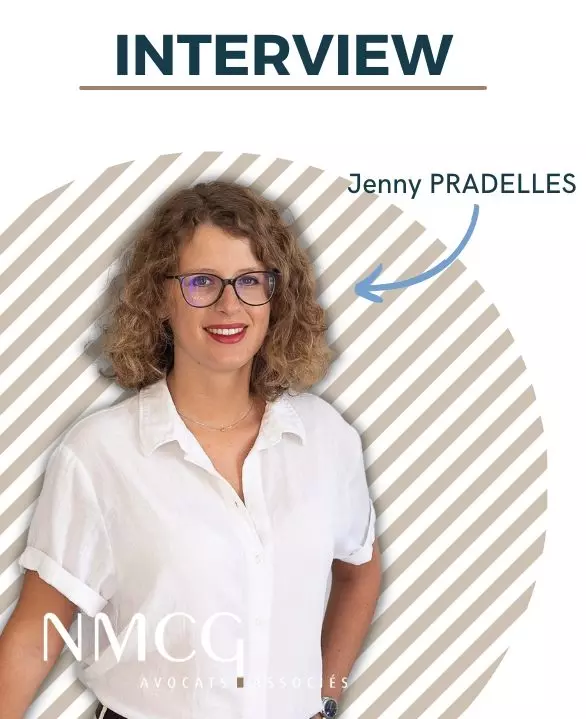

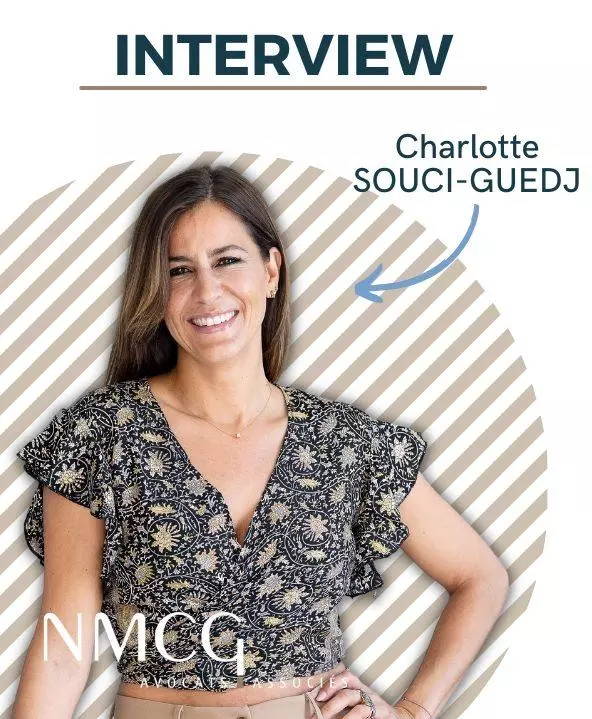

![L'alcool et les produits stupéfiants au travail [...] Partie 3 (3/3)](https://www.nmcg.fr/wp-content/uploads/2023/03/17-e1677765500171.jpg.webp)